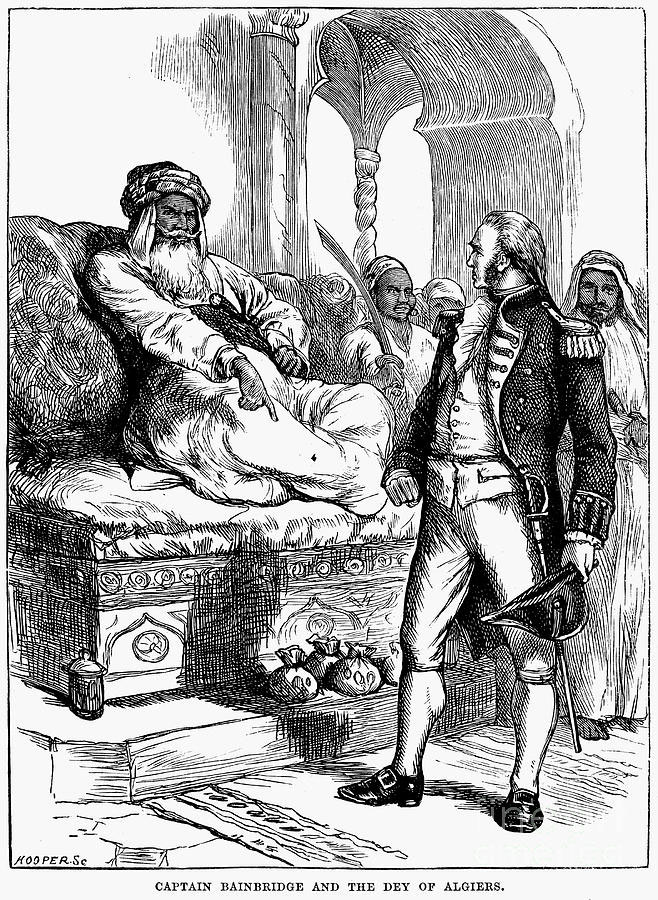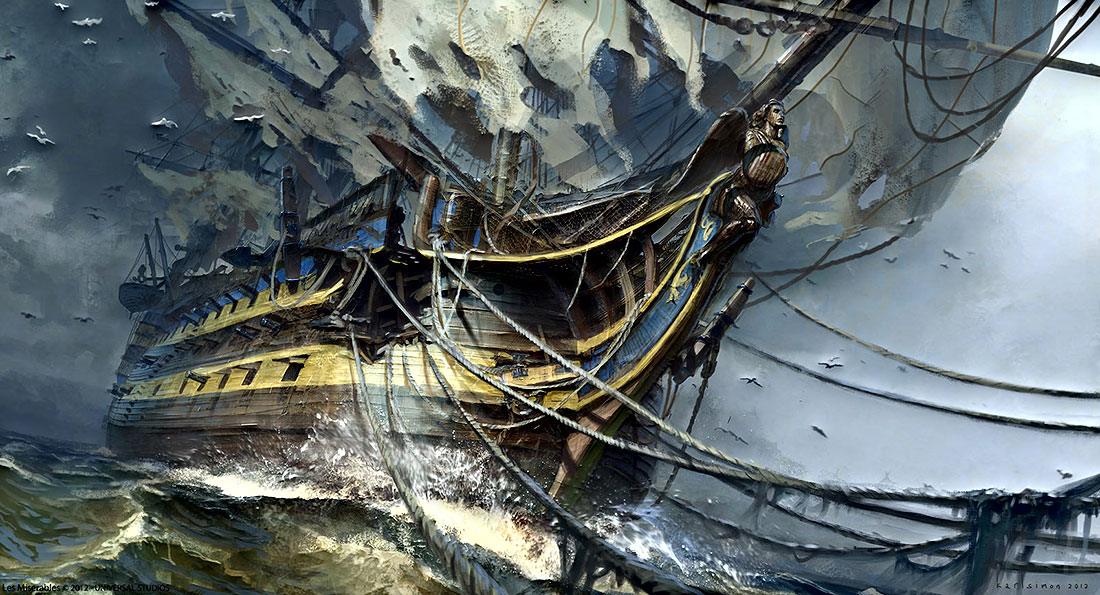
L’EFFONDREMENT
La marine d’Alger ne pouvait
échapper aux conséquences de profondes crises politiques et
économiques qui secouèrent le pays à partir du XVIIIème siècle ainsi
qu’aux changements qui survinrent dans les Etats européens et en
Méditerranée.
Un concours de circonstances
défavorables allait, à la veille du XIXème siècle, desservir
directement ou non, cette organisation qui montrait peu à peu, des
signes d’essoufflement. La décadence, puis la chute ont des causes
aussi nombreuses que diverses que nous allons tenter d’analyser.
A - LES CAUSES INTERNES
1 - Dégradation
de la situation politique
Les processus de la décadence,
entamée peu à peu, apparaissaient au grand jour. Depuis quelques
décennies, la Régence était minée par les germes de destruction.
Colonie d’exploitation et
république militaire, le pays ne supportait plus d’être gouverné par
une minorité turque, vivant en vase clos et se réservant l’exercice
et le bénéfice du pouvoir. Avec le temps, elle avait perdu l’esprit
offensif des premiers jours ainsi que l’esprit de corps qui firent,
jadis, sa légendaire puissance.
La milice se distinguait par sa
désobéissance, ses appétits déchaînés, son goût pour les troubles et
l’usurpation de l’autorité par la violence.
Cette soldatesque corrompue
voyait, cependant, ses effectifs diminuer de façon continue. Les
recrues dans les provinces ottomanes se firent de plus en plus
rares. Si, en 1628, Dan parlait de 22.000 janissaires, les dernières
années n’offraient que 4.000 dont plus de 3.000 invalides « Taïfa et
Odjaq compris. »
Le pouvoir central, déjà
affaibli par les drames de palais sanglant, ne contrôlait pas tout à
fait la situation. Après le Dey ‘Uthmân et les Beys Muhammad
al-Kabîr et Sâlah de Constantine, on ne trouve plus aucune figure
parmi les dirigeants, capable de faire respecter l’état et ses
instructions.
Le Dey de la dernière période
n’était plus, comme avant, « souverain indépendant allié au Sultan,
maître absolu, commandant les forces et les rouages de la Régence. »
Il devint : « l’esclave de ses esclaves... vivant dans une
continuelle méfiance, occupé à déjouer les trames qui menaçaient ses
jours. »
Ces « pachas » disparaissaient
par le feu ou par le poison. Leur autorité, même limitée, était mal
acceptée. La dégradation du système fut telle que de 1798 à 1830,
six Deys furent assassinés sur huit. Leurs femmes furent dépouillées
de leurs biens, et leurs enfants réduits à la simple paie des
soldats et exclus de tous les avantages et charges de l’Etat.
Le pouvoir s’usait et la
détérioration s’accentuait. Les Beys, devenus semi-indépendants,
s’enrichissaient démesurément, alors que le gouvernement
s’appauvrissait. Les foudres de ce dernier n’allaient pas épargner
ces roitelets. De 1790 à 1825, huit d’entre eux furent destitués et
seize exécutés. Constantine connut de 1803 à 1825 seize Beys[1].
Ces chefs de provinces étaient
surveillés ou concurrencés par l’Agha des Mehalla (Mehalli aghassi)
qui intervenait dans leurs affaires. La méfiance réciproque, la
cupidité et les règlements de compte épuisaient le pays et le
précipitaient dans une anarchie dangereuse et des jours sombres. Les
Beys humains ou équitables étaient accusés de trahison et payaient
de leur vie ou de leurs biens. Les autres, tyrans et sans scrupule,
comme Tchakerli à l’Est et Hassan à l’Ouest étaient les artisans de
nombreux malheurs. Certains se soulevaient contre le pouvoir central
et harcelaient les forces du Dey, permettant ainsi aux ennemis
extérieurs de préparer avec succès, les coups qui devaient achever
la Régence.
La violence devenue méthode de
gouvernement, fit oublier les problèmes de défense et de gestion.
Les révoltes intérieures dues à la misère, l’oppression et les
charges fiscales avaient fait perdre au régime de précieux
auxiliaires, et le rendant vulnérable. Les Juifs, véritables
maîtres, dictaient aux responsables la politique qui les
avantageait. Ils favorisaient souvent les Anglais quand les Français
donnaient chichement. L’or des premiers « faisait des ravages dans
les consciences » venait de remarquer un observateur ! Le commerce,
source principale de richesses, échappait aux autochtones. Le pays
était la proie des disettes, des horreurs et du vide menaçant.
2 - Une marine condamnée
Le temps où la marine d’Alger «
était la plus puissante du globe par le nombre, la force de ses
vaisseaux, l’audace et l’habileté de ses marins[2]
» était révolu.
Les problèmes qu’elle
affrontait étaient généralement insolubles. Les Juifs
s’introduisaient partout où il y avait beaucoup d’argent à gagner.
Aussi le Dey Mustapha leur accorda, en 1799, le privilège de la «
Karasta. » Les Moqrânî venaient d’y renoncer. Bouchnac et Bacri
recevaient en espèces le montant des livraisons de bois débité pour
la marine d’après des tarifs établis en... 1702, augmentés d’une
commission d’environ 20% pour les peines, travaux, soins, frais et
transport. Ensuite, nos deux Juifs établirent une série de prix
nouveaux en rabais considérable sur ceux perçus par les habitants de
la région depuis longtemps lors des livraisons. Mécontentes, les
tribus employées à la coupe, refusèrent de laisser embarquer le bois
amassé sur la côte.
Les chantiers navals d’Alger en
souffrirent et la construction fut ralentie. Les vaisseaux perdus ou
engagés en Orient, entre 1812 et 1826, ne purent être totalement
remplacés[3].
E.de la Primaudaie estimait la flotte forte de quatorze unités en
1825 et sa puissance de feu entre 320 et 336 canons[4].
Au refus des tribus victimes de
la cupidité, s’ajoutèrent les révoltes antiturques des montagnards
et les difficultés de faire parvenir le bois à Alger, à partir de
1827.
La situation devint alarmante
pour une marine qui ne pouvait ni rajeunir ni entretenir sa flotte
Le Dey se tourna bien vers les Banî Djenâd qui possédaient les
riches massifs de chênes zen. Dans une de ses lettres, il exprima
clairement les difficultés dans lesquelles il se débattait:
« Nous désirons, écrit-il,
que vous vous occupiez avec nous de la coupe de bois que nous avons
besoin de prendre chez vous. Vous nous prêterez ainsi votre concours
par le Jihâd [...] Envoyez-nous deux notables de la Djem’a et des
cheikhs intelligents ; nous nous entretiendrons avec eux au sujet
des dimensions [des pièces] et autres choses. »
Cependant, malgré les appels et
les avantages concertés, les Banîs Djenâd ne donnèrent, aucune suite
aux propositions du gouvernement...
Quant à l’état des navires
existants, il était loin d’être satisfaisant. Ce mauvais état
d’armement fut déjà signalé par Dubois-Thainville[5].
Et bien avant la chute, les signes de décadence étaient repérés par
les observateurs. La marine algérienne, écrit Boutin, dans son
mémoire, est nulle pour nous, même si son opinion est exagérée. Le
jugement de cet agent de Napoléon était probablement dicté par deux
éléments : la baisse des effectifs et l’âge des unités en service.
En effet, 3 frégates de 50, 46 et 44 canons ; 7 chébecs de 12 à 32
canons ; 3 polacres de 10 à 22 canons ; 10 chaloupes canonnières
pontées et en état de tenir la mer... 50 chaloupes canonnières non
pontées et d’anciennes constructions pour la défense du port, mises
à la mer en mai et replacées dans les magasins en octobre... 2
galères pour la défense du port et quelques petits corsaires de 4 à
6 canons, telle était la flotte d’après Boutin.
Les états des forces maritimes
des puissances européennes étaient, à cette époque, en progression
constante et bénéficiaient des progrès techniques qui manquaient
cruellement à notre marine. Ni la mission à l’étranger, ni
rénovation dans les arsenaux. On ignorait tout des progrès
techniques de l’époque.
Si la construction sur place
périclitait, l’achat de navires à l’étranger se poursuivait avec les
inconvénients dus à la situation. Les transactions ne semblent pas
avoir été heureuses pour les Algériens. Un officier de la marine
belge, le commandant Crombet, fit une brève visite à Alger, en mai
1817. Il y trouva une frégate « qui a l’air d’avoir rendu de longs
services » vendue à la
Régence par le Grand Seigneur (le Sultan) « avec deux jolies
circasiennes pour la somme exorbitante de 500.000 piastres fortes,
faisant argent de France 1.500.000 frs, somme pour laquelle, disait
en société le consul d’Angleterre, M. Mac Donald, l’Angleterre leur
aurait donné vingt belles corvettes toutes armées[6].
»
Husayn Pacha (1818-1830), très
au courant des problèmes internationaux, comprit la nécessité et
l’urgence d’une solution à la crise de la marine. Dans une lettre
datée du 18 juillet 1819, adressée au sultan Mahmûd II, on le voit
solliciter de La Porte « des ingénieurs pour la fabrication des
armes pour enseigner ce métier aux Algériens... Pour que nos
janissaires puissent vaincre leurs difficultés, nous vous prions de
nous envoyer les munitions suivantes : 40 canons en cuivre, 3.000
bombes format 18, 3.000 format 12 ; 6 pièces d’obus à 2 tonnes,
15.000 quintaux de poudre noire, 2.000 quintaux d’huile et de
naphte, 500 quintaux de goudron, 1.500 quintaux de poix, 40
frégates, 60 vergues de frégates, 1.000 armes, 150 quintaux de
chanvre, 2.000 quintaux de fer brut, 2.000 quintaux de cuivre, 1.000
canons en fer et 1.200 grosses voiles. »
S’adressant à Kursu Pacha,
Ministre de la Marine ottomane, le Dey lui réclamait l’envoi de
bateaux de guerre ainsi que « des facilités de recrutement de
janissaires de l’Anatolie pour renforcer le potentiel militaire,
face aux menaces de la France et de l’Angleterre[7].
»
Mais le Sultan avait ses
problèmes propres et ses difficultés. La Régence, ne pouvant
construire ses bâtiments et fabriquer ses armes et munitions, en
quantité suffisantes pour faire face à une situation explosive,
courait peu à peu à sa perte[8].
La situation était pénible pour
les responsables : « Il y a six ans, nous dit Boutin, on fondit
quelques canons par forme d’expérience. On acheta du bronze pour en
fabriquer d’autres, mais ce fut l’échec. On fabriquait bien de la
poudre mais elle était défectueuse[9].
»
Les navires à rames, très
efficaces pour la course en raison de leur légèreté et leur vitesse,
ne pouvaient être presque d’aucune utilité pour les actions
militaires[10].
Les bâtiments étaient restés fragiles, donc incapables d’affronter
le mauvais temps. Leur espace était étroit et « occupé pour
l’essentiel par le moteur humain. » L’artillerie était réduite et
concentrée à l’avant. Alors que les autres marines avaient
enregistré des progrès techniques appréciables, nos navires étaient
tout juste bon « pour des coups de mains et des razzias et non des
conquêtes en profondeur[11].
»

3 - Pénurie de marins
Le recrutement n’amenait plus,
à Alger, que de rares volontaires. La pénurie de marins constituait
un véritable péril.
On trouvait peu de gens à
enrôler. La situation devint telle que « lorsque les équipages des
corsaires qui allaient en course n’étaient point complets, quelques
sbires faisaient embarquer à coups de bâton des Biskrîs, des Kbai’ls
et des Maures[12]».
Les quelques marins de profession étaient usés par les longues
sorties. Ils étaient devenus presque tous infirmes.
Quant aux Raïs, leur nombre et
leur qualification étaient source d’inquiétude. Certains n’étaient
que « des écumeurs de mer moitié marchands, moitié pirates. »
D’autres préféraient rester à terre ; exerçant des petits métiers ou
préférant des emplois de drogman dans les consulats. Quelques-uns
servaient de pilotes aux navires de commerce. On dit qu’entre 1800
et 1816, trente-quatre capitaines seulement prenaient la mer[13]
! En général, ils ne songeaient plus qu’à vivre chichement des
maigres revenus que leur procuraient leurs sorties en Méditerranée,
de temps à autre. La Régence souffrait de la disette d’habiles
marins.
Les officiers de mérite
manquaient. Le peu d’expérience de ceux qui commandaient encore, et
le peu de batailles engagées en mer, enlevèrent à la marine son
efficacité et son mordant de jadis. « Il n’y a plus, sur le navire,
constate Dubois-Thainville, l’ordre et la discipline légendaire »
qu’enviaient les autres flottes. Les responsables éprouvaient de
grandes difficultés à faire observer une bonne discipline à leurs
soldats et leurs marins, lesquels, disait Shaw « prétendent avoir
autant d’autorité que leurs officiers[14].
»
Au manque de potentialité
humaine, s’ajoutaient les conditions de travail éprouvantes. Les
provisions emportées se limitaient à peu d’huile « infecte, »
quelques olives et du biscuit « souvent gâté» : c’étaient les vivres
du bord ! On était loin du temps où les provisions suffisantes,
variées et appétissantes ragaillardissaient le marin.
Un découragement général semble
avoir gagné, dès la première moitié du XVIIIème siècle, les milieux
de la marine. Parlant d’eux, Shaw avait constaté une anomalie qui
laissait perplexe : « Ils ont, dit-il, une grande quantité de
matériaux pour bâtir des vaisseaux, de sorte que s’ils voulaient
reprendre courage et établir, parmi eux, une bonne discipline, ils
pourrait beaucoup incommoder les Européens. »

4 - Pénurie d’argent
La disette de bons marins ne
fut que la conséquence de la disette d’argent.
La paix avec certaines nations
commerçantes, notamment après le traité algéro- espagnol de 1786,
avait limité sérieusement l’action des corsaires Les recettes, dont
une bonne partie provenait des tributs payés par les nations
maritimes, ne pouvaient couvrir, même en partie, les besoins du
gouvernement. En 1822, quatre Etats payèrent à la Régence,
quatre-vingt-seize mille dollars espagnols[15].
Et les autres ressources,
pourrait-on dire ? Le commerce était maladroitement ruiné par les
Deys qui s’en accaparèrent et les Juifs qui s’enrichissaient aux
dépens du pays. Certains négociants devinrent les créanciers de
l’Etat, et lui dictaient leurs volontés.
L’âge d’or de la course était
passé fini depuis quelques temps. La source des fabuleux revenus
avait tari. Déjà, vers 1780, les consuls en poste ici, avaient
remarqué cet infléchissement : « On ne voit plus arriver dans le
port d’Alger que des prises de peu de valeur et en petite quantité »
écrit Vallière[16].
Les sorties en mer ne duraient
que cinq ou six jours[17],
au lieu de deux ou trois mois ! Aussi, les diminutions furent de
plus en plus sensibles : en 1771, 4.350 francs de prises ; entre
1765 et 1792, la valeur ne dépassa pas 581.580 francs. Certaines
années, les prises tombaient à presque rien[18].
Les obstacles, de plus en plus
nombreux, devaient freiner les opérations de course. L’Europe passa
de la défensive à l’offensive. Les marines chrétiennes montèrent une
agressivité dangereuse. En 1620, La flotte anglaise fit son
apparition en Méditerranée. Elle devait régner, à partir de ses
bases de Minorque, Malte et Gibraltar, sut une grande partie de
cette mer.
Les Français pratiquaient le
course dans la zone la plus serrée du détroit entre Tarifa et Ceuta.
A Messine, sur les côtes de Sicile, les corsaires français étaient
nombreux et actifs en dépit de la neutralité de l’île.
Nelson faisait croiser ses
corsaires entre Gibraltar et la côte d’Afrique. Ceux qui opéraient
sur la côte de Tunisie n’hésitaient pas, quand l’occasion leur
semblait bonne, à se couvrir du pavillon du Bey déclarant tantôt
qu’ils étaient Français et tantôt sujets du Bey[19].
Les galions armés, aux flancs
très élevés, ne craignaient plus l’abordage et leur puissance de feu
maintenait éloignés les éventuels assaillants.
Les convois de bateaux protégés
par des unités de guerre assuraient au trafic maritime une sécurité
accrue. A ces dispositions, il faut rappeler que les corsaires
chrétiens ne restaient pas inactifs, ils s’emparaient des navires
algériens, pillaient les côtes, enlevaient les riverains et leurs
biens, pendant que les escadres des grandes puissances bombardaient,
régulièrement, les ports et coulaient la flotte ou bloquaient
l’activité des marins durant la bonne saison. Très souvent, nos Raïs
furent contraints à l’inaction. Ainsi, la belle organisation se
détériora et la technique qui fit jadis ses preuves se dérégla. Les
moyens humains et matériels firent souvent défaut. L’enthousiasme
fit place à la crainte, les profits légendaires ne furent plus que
des souvenirs[20].
La pauvreté, due au manque à gagner, affecta la marine dans la
construction, l’entretien et la paie des matelots.
La crise économique s’aggrava
sous le règne de Hadj ‘Alî et faillit mettre en cause l’existence
même de l’Etat, sous ‘Umar Pacha (1815-1817). Sa lettre au Sultan
Mahmûd II décrit la situation financière déplorable : « ... à
l’ordre de Votre Majesté de libérer un certain nombre de citoyens,
nous avons répondu par l’obéissance en libérant une frégate, quant à
l’argent réclamé, nous n’avons pas la possibilité de le rendre. Tout
a été pris et dispersé. Depuis dix ans, le Dey Mustapha a été
remplacé par le Dey Ahmad. Celui-ci, à la suite de la révolte de
tous les soldats, a doublé la solde aux militaires, par conséquent,
les caisses sont vides[21].
»
Le tableau des dépenses du
gouvernement, dressé en 1822, montre le déséquilibre qui précipita
la chute de la marine.
* Ouvriers, artistes
(artisans), etc., qui travaillaient dans les chantiers :
21.000 dollars esp
* Achat de bois de charpente,
cordage :
60.000
dollars esp
* Solde des officiers de mer et
des marins :
75 .000 dollars esp
* Solde des militaires de tous
grades[22] :
700.000
dollars esp
La sécurité intérieure du pays
avait fait passer au second plan la sécurité extérieure.
5 - Un Dey têtu
Malgré l’ouragan politique et
militaire qui menaçait le pays, Husayn sous-estimait trop la
puissance de l’Europe. Il comptait trop sur les divisions de cette
dernière. Il méprisait son opinion publique et se complaisait dans
une analyse erronée de la situation internationale. La campagne
anti-algérienne se développait suite aux rapports de Deval, aux
écrits de Pananti, aux prises de positions de Chateaubriand. Les
projets d’occupation se multipliaient et les rappels se faisaient
pressants. Prendre Alger à revers était dans toutes les bouches.
L’option de Sidi Ferruch circulait déjà.
Alors que l’orage menaçait,
Husayn adoptait une attitude bizarre. A Harry Neal qui vint en 1824
promettre une guerre destructrice, et parler de la puissance
anglaise, le Dey répondit : « Nemrod, le plus fort et le plus
puissant des hommes est mort de la piqûre d’une mouche[23].
» Ses prises de position n’allaient pas toujours dans le sens de
l’intérêt de la Régence. En 1826, il proposa au Diwân, malgré une
situation préoccupante, de déclarer la guerre, simultanément, à la
Hollande et aux Etats Unis. Certes, son prédécesseur avait bien
bravé Napoléon, alors au faîte de sa puissance, mais le temps ne
travaillait plus, depuis, en faveur de la Régence. Quand le blocus
d’Alger devint effectif, le Dey, dans une lettre au Sultan, osa
écrire : « bien que jusqu’à présent, les vils mécréants Français
assiègent par mer, l’Odjaq victorieux avec six ou sept navires
puissants, nous n’avons, Dieu merci, absolument besoin de rien [...]
et avons la capacité de repousser les attaques non seulement des
Français, mais des autres nations, si elles nous assiègent ensemble.
»
L’entêtement du Dey était
incurable. En 1827, arrivait à Alger un ambassadeur de La Porte. Sa
mission consistait à presser le maître du pays « d’organiser comme
le Sultan et suivant les méthodes modernes, une armée de quarante
mille hommes. » Le Pacha resta sourd aux injonctions de son
souverain, et ne voulut rien entreprendre. « Je suis, dit-il, trop
bon Musulman pour imiter les innovations des infidèles » et laissa
entendre à l’envoyé qu’il était maître absolu chez lui.
Quelques temps après, Muhammad
‘Alî, Pacha d’Egypte, essaya de secouer l’aveugle opiniâtreté du
Dey. Il lui conseilla de ne pas mécontenter le Sultan et lui
conseilla, également, de terminer ses démêlés avec la France. Ce fut
peine perdue !
L’historien, az-Zahhâr, le
condamne sans appel : « Satan lui insuffla (des idées) [...] il fit
preuve de prétention et de suffisance... Il crut que personne ne le
battrait [...] Il refusa, les propositions de Hadj Khalîl Effendi
[...] l’ennemi de Dieu ne faisait que persister dans son entêtement
et son oppression [...] Il repoussa les conseils de Muhammad ‘Alî[24].
Le capitaine Dupetit Thouars
écrivait en 1827 que « la confiance des Algériens dans leurs forces
et leur supériorité sont inimaginables... Elle se base
principalement sur leurs dernières affaires avec la Grande
Bretagne...»
Si le dernier Dey ne manquait
ni de courage ni d’autorité, il manquait d’imagination et de
souplesse qui auraient épargné, à la marine, bien des sacrifices et
des déboires.
La centralisation à outrance
avait fait perdre à la marine les avantages des autres port du pays
: Celui de Mars al-Kabîr « excellent, praticable à toute espèce de
bâtiments et préférable, même, à celui d’Arzew[25].
» Le Dey n’avait pas su aménager d’autres lieux de mouillage ou
d’autres chantiers. Il ignora les possibilités des rades de Stora,
de Collo ou de Bijâya.
Tout était concentré dans les
murs d’Alger. « Toutes les forces de la Régence sont là, dit le
rapport de Saint-Martin, et c’est là seulement que l’on peut la
frapper[26].
»
Nous avons fait ressortir les
principales causes internes de la décadence, examinons, maintenant,
les causes externes.
[1]
Par contre, de 1746 à 1792, soit près d’un demi-siècle, la
ville n’a connu que quatre Beys.
[2]
Perrot, Esquisse..., p. 75.
[3]
Garrot, Histoire de
l’Algérie, pp. 654-655.
[4]
Le Commerce..., p. 29, n.l.
[5]
A.N.Aff.Etr. Mémoires et Documents, t. 14, Algérie.
« Les navires ne retournent
jamais d’une croisière, même dans la belle saison, sans
avoir besoin de réparations considérables » dit Dubois
Thainville (Mémoires sur Alger, p. 140).
[6]
Crombet, « Alger au temps des Turcs, » Revue de
Paris, n°65/1958, pp. 80-87.
Cet officier écrit
cependant : « A une remarque que pareil marché était
contraire aux intérêts de l’Humanité (allusion à la course)
le consul répondit : Et pourquoi pas ? Ce serait un gain
pour l’Angleterre et puis, dans tous les cas, on pourrait
toujours venir les brûler quand on trouverait bon. »
[7]
Temimi (A), Le Beylik de Constantine, p. 34.
[8]
Dès la fin du XVIIIème siècle, la construction navale
française enregistrait de sérieux progrès.
En 1688, il y avait à
Toulon 48 vaisseaux de lignes. En moins de quatre ans, neuf
nouveaux vaisseaux furent mis à l’eau.
La fonderie du port
était très active et les ateliers s’affairaient sans
relâche. En 1692, on éprouva à Toulon une matière
combustible avec laquelle on aurait pu mettre le feu aux
vaisseaux ennemis.
En 1694, l’armée navale était
encore plus forte avec 110 vaisseaux de ligne.
[9]
Boutin, Reconnaissance..., pp. 48-49.
[10]
Amiral Emo, R.A., 1951, p. 190.
[11]
Aymard, « Chiourmes et Galères, » Mélanges,
F.Braudel, I, p. 50.
[12]
Dubois-Thainville, Mémoire sur Alger (1809), p. 140.
[13]
Vers 1620, plus de trois cents Raïs sillonnaient la mer.
Parmi eux, plus de quatre-vingt commandaient les gros
bâtiments.
[14]
Shaw, Voyages, pp. 88-89.
[15]
Shaler, Esquisse, p. 49. Le Roi de Naples : 24.000
dollars, la Suède : 24.000 dollars, le Danemark : 24.000
dollars, le Portugal : 24.000 dollars.
[16]
Vallière, « L’Algérie en 1781, »publi.
Chaillou, p. 81.
[17]
Hamdân Khodja, al-‘Mir’ât, p. 170.
[18]
Plusieurs fois durant la seconde moitié du XVIIIème siècle,
la valeur des prises n’atteignit pas 100.000 francs or par
campagne.
[19]
Douin, Histoire de la Méditerranée, p. 103.
Dans ce dernier cas, précise
l’auteur, pour ajouter à l’illusion, leurs hommes se
coiffaient de turbans.
[20]
Raïs Hamîdû rendit cependant à la course sa rentabilité. A
la faveur des guerres intereuropéennes, entre 1793 et 1801,
la valeur des prises avait atteint des chiffres inconnus
pendant tout le XVIIIème siècle.
[21]
Temimi (A), Recherches et Documents 1816-1817, pp.
106-107.
[22]
Shaler, Esquisse, p. 49.
[23]
Grammont, Histoire, p. 386.
[24]
Zahhar, Mudhakkirât, pp. 166-167.
[25]
Boutin, Rapport in Mémoires et Documents, t.14,
1825-1830.
[26]
A.N.Aff.Etr. Mémoires et Documents, t. 14
(1825-1830).