
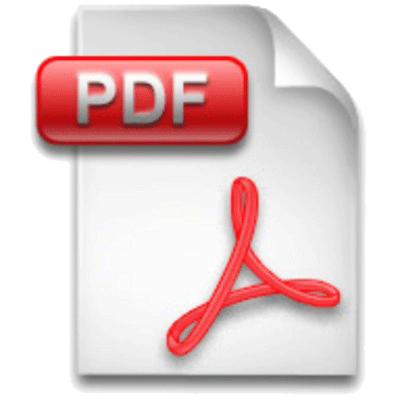 |
Lépante
Le récit suivant de la politique ottomane menant à la
bataille de Lépante et de son effet immédiat sur les
Ottomans est basé exclusivement sur des documents des
archives turques.
Au mois de Ramadan 978 (février 1571), la Porte reçut des
renseignements des Begs de Kilis (en Bosnie) et de Delvina
que les Vénitiens rassemblaient leurs forces près de Korfu
et attendaient la flotte espagnole. D’autres rapports
provenant de diverses sources confirmèrent la nouvelle. Le
Beg de Morée rapporta que la flotte vénitienne en Crète,
forte de trente navires, avait cruellement besoin de
provisions et prévoyait de capturer les navires marchands
transportant des provisions d’Egypte et de Syrie à Istanbul.
Les nouvelles concernant la flotte chrétienne provoquèrent
une grande inquiétude et une grande excitation à Istanbul et
le Divan impérial prit des mesures drastiques pour faire
face au danger imminent. La Porte était principalement
concernée par les tentatives chrétiennes de briser le siège
ottoman de Famagouste. La stratégie pour empêcher une telle
intervention consistait à envoyer d’abord des renforts au
commandant en chef ottoman à Chypre pour achever la conquête
de l’île, puis de rassembler toutes les forces navales
ottomanes sous un seul commandement pour empêcher la flotte
chrétienne de venir à la l’aide des assiégés à Famagouste et
de la destruction de la flotte alliée. La décision de la
Porte d’attaquer la flotte chrétienne fut une décision
fatidique qui déterminerait désormais le cours des
événements.
A cet effet, les mesures suivantes furent prises : le Beg de
Rhodes qui surveillait les navires vénitiens en Crète fut
immédiatement renforcé par vingt navires envoyés d’Istanbul
sous Kaya Beg de Koca-ili à la mi-Ramadan. Muhammad
Shoulouk, le Beg d’Alexandrie fut nommé commandant de toutes
les forces qui allait se rassembler à Rhodes avec pour
instructions d’attaquer tout navire vénitien tentant de
s’infiltrer dans les eaux de Chypre et de transporter des
troupes de Tripoli (en Syrie) à Chypre. Il décida également
d’accélérer les travaux à l’arsenal impérial d’Istanbul pour
achever les navires en construction. (Après la défaite de
Lépante, on dit que l’échec à terminer les navires fut l’une
des raisons de la défaite). Muezzin-zade ‘Ali Bacha,
l’amiral de la flotte ottomane, partit pour Istanbul avec
trente galères le 24 Shawwal (21 mars) et arriva à Chypre
fin mars. Il reçut l’ordre de rassembler toutes les forces
de la Mer Égée et de se rendre à Chypre. Il apporta à Chypre
des soldats, des munitions de Tripoli et prit part au siège
de Famagouste.
Dans l’intervalle, la Porte assigna le deuxième Vizir
Bartawi (Pertev) Bacha commandant en chef de toutes les
forces navales naviguant d’Istanbul avec les navires
restants, au nombre de 124, le 9 Dzoul Hijjah 978 (4 mai
1571). Il devait rassembler toutes les forces sous son
commandement et attaquer la flotte alliée partout où il la
trouverait. L’inspection montra que le nombre total de
navires à rames était de 227, dont 35 avaient des esclaves
comme rameurs et le reste des Musulmans, des rameurs enrôlés
dans les provinces ottomanes. Vingt navires devaient être
laissés à Chypre pour servir de garde et de transport. Le
Kapudan Muezzin-zade Bacha fut informé que la décision
d’attaquer la flotte chrétienne était définitive et
fortement soutenue par tous les Musulmans. Dans les mots du
document : « Lorsque la nouvelle de l’intention d’attaquer
des mécréants devint connue de tous ici, les ‘ulémas et
toute la communauté musulmane trouvèrent qu’il était plus
approprié et nécessaire de trouver et d’attaquer
immédiatement la flotte des mécréants afin de sauver
l’honneur de notre religion et de notre état, et pour
protéger le pays du Califat et, lorsque les Musulmans
soumirent leur pétition aux pieds de mon trône, je l’ai
trouvée bonne et incontestable, je reste inébranlable dans
ma décision. »
Ce passage reflète clairement le fait que les Ottomans
réalisèrent pleinement la gravité du moment. Comme le
suggère le langage du document, dès le début, les Ottomans
virent la confrontation comme une confrontation entre deux
religions, réciproquant à cet égard les motivations des
architectes de la Sainte Ligue, le Pape Pie V et le Roi
espagnol Philippe II. La décision fut mise en œuvre d’un
seul coup et toutes les forces navales et terrestres furent
appelées à se joindre à l’opération.
La guerre pour Chypre entra ainsi dans une nouvelle phase
avec un intense esprit de combat des deux côtés. Dès lors,
les Ottomans essayèrent de mobiliser toutes leurs ressources
pour la lutte fatidique. Le Sultan nomma le troisième Vizir
Ahmed Bacha commandant en chef de l’armée de terre
qui comprenait 1500 janissaires et environ 1500 cavaliers de
la Porte avec la cavalerie provinciale sous le commandement
de Huseyin Bacha, le Beylerbeyi de Roumélie. Ahmed
quitta Istanbul le 4 Dzoul Hijjah (29 avril) et
atteignit rapidement Uskup (Skoplje) pour rassembler les
troupes.
Muezzin-zade quitta Chypre pour rejoindre Bartawi Bacha le
14 Dzoul Hijjah (9 mai). En apprenant la nouvelle que
la flotte vénitienne de Crète était en mauvaise posture en
raison de la perte de son équipage en raison d’une épidémie
et de la réticence de la population locale à servir, le
Porte envoya un ordre à Bartawi Bacha, commandant en chef
des forces navales, d’attaquer l’ennemi en Crète, d’attaquer
les îles et les forteresses de la région et d’assaillir les
navires vénitiens qui s’étaient rassemblés à Corfou. Si cela
réussissait, il devait attaquer les forteresses côtières
vénitiennes et détruire la forteresse de Parga. Les forces
terrestres sous les Begs de Joannina et Delvina devaient
coopérer avec lui dans la dernière entreprise.
Dans les chroniques ottomanes de Selaniki, ‘Ali, Louqman et
Zeyrek, le récit des opérations navales est très bref.
Zeyrek nous dit que les forces ottomanes effectuèrent des
raids dévastateurs en Crète, Cerigo (Chouha Adasi), Zante
(Zakilise), Céphalonie et Corfou, prirent et détruisirent
les forteresses de Sopot (en Albanie), Dulcigno (Oulkun),
Antivani (Bar) et Boudua. ‘Oulouj ‘Ali, le Beylerbeyi
d’Algérie rejoignit la flotte avec ses vingt galères près de
la Crète. Nous trouvons plus de détails dans la chronique
contemporaine de la cour
Salimname de
Louqman (Bibliothèque Sarayl de Topkapi Sarayl, R.1537)
illustrée d’exquises miniatures. Il décrit comment Ahmed
Bacha arriva à Shkoder (Igkodra) et prit d’assaut Dulcigno
en coopération avec les forces navales sous Bartawi Bacha.
La nouvelle de la capture de Dulcigno fut reçue avec une
grande joie dans la capitale ottomane, et Ahmed Bacha
en fut récompensé par le Sultan. Il est intéressant de noter
cependant qu’au cours de cette opération, de nombreux
combattants ottomans qui avaient débarqué pour combattre
désertèrent et ne sont jamais revenus sur leurs navires.
Selaniki ajoute que de nombreux navires se retrouvèrent
ainsi sans soldats.
Quand Ahmed et Bartawi furent sur le point de se
déplacer contre Kotor, ils apprirent que la flotte alliée
était finalement apparue dans la Mer Adriatique mais
décidèrent de se retirer. Sur ce, la Porte émit l’hypothèse
que l’intention de l’ennemi était de frapper les possessions
ottomanes sur les côtes adriatiques et des mesures
énergiques furent prises pour éviter cela. En juillet,
l’information arriva d’Avlona (Vlore) que la flotte
vénitienne s’était rendue à Messine. En août, plusieurs
ordres furent envoyés aux Begs et aux qadis en Roumélie avec
l’avertissement de se préparer contre une attaque ennemie.
Le Beg de Kjustendil devait garder la côte d’Alessio (Lesh)
jusqu’à Durazzo (Durres) en Albanie, et les qadis de
Roumanie reçurent l’ordre de fournir des provisions et du
matériel chaque fois que le capitaine de la flotte le
demandait depuis les quartiers d’hiver de Bis.
L’ordre est particulièrement intéressant pour montrer la
situation du côté ottoman en septembre. On y lit : « Ordre à
‘Ali Bacha, amiral de la flotte impériale. Dans ta lettre du
18 Rabi’ ath-Thani (9 septembre), tu as signalé que mon
précédent firman au sujet de ton hivernage avec les
Beylerbeyi d’Algérie au port de Kotor t’es parvenu à Lépante
(Inebahti), tu as indiqué que dans une lettre ‘Ali, l’un des
capitaines d’Algérie qui a été envoyé à Messine pour
capturer des prisonniers pour des renseignements, t’a écrit
que la flotte des incroyants était entrée dans le port de
Taranda (Otrante) et qu’il avait capturé un petit navire de
leur flotte. Les captifs l’informèrent que l’Espagne et
Venise avaient équipé tous leurs navires, y compris ceux de
Crète, et avaient décidé de venir à Corfou sous le
commandement de Don Juan, le frère du roi d’Espagne afin
d’attaquer soit la flotte impériale, soit une place sur les
côtes de nos dominions. Tu ajoutes que toute la situation
serait discutée au conseil de guerre et que le mieux sera
fait pour les choses concernant notre religion et notre
état. Tout ce que tu as rapporté nous était connu. De plus,
Mustafa, un de mes chavoushes, apporta la nouvelle qu’il
avait apprise de Bayazid, le Beg de Delvina, que la flotte
des mécréants était déjà arrivée à Corfou. Bartawi Bacha,
mon commandant en chef, m’a également rapporté les choses
que tu voulais soumettre à ma connaissance. Maintenant,
j’ordonne qu’après avoir reçu des nouvelles fiables sur
l’ennemi, que vous attaquiez la flotte des mécréants en
faisant pleinement confiance à Allah et à Son Prophète. Dès
que mon ordre arrivera, vous devez rejoindre Bartawi Bacha
et tenir un conseil avec les Beylerbeyi d’Algérie, d’autres
beys, zou’ama et capitaines de la marine agissant tous en
parfait accord et unité selon ce qui est jugé le plus
approprié ... Si vous pensez que ma flotte impériale devrait
hiverner par la volonté d’Allah dans ces eaux comme je
l’avais envisagé dans mon ordre précédent, vous pouvez
décider de rester dans le port de Kotor ou dans un autre
port après avoir consulté Bartawi Bacha, et me soumettre les
mesures que vous prendrez pour pouvoir agir conformément à
quoi que sera mon commandement impérial. »
Nous apprenons d’un ordre au Kapudan Bacha en date du 26
Rabi’ ath-Thani (17 septembre), que lorsque la flotte
ottomane partit pour Avlona, un escadron de cinq galères
ennemies arriva dans le détroit de Kotor, mais Qasim, le Beg
d’Hersek (Herzégovine) les repoussa et fit des prisonniers.
Il apprit d’eux que la flotte chrétienne composée de 130
vaisseaux espagnols et 130 vénitiens devait assiéger Nova
(Castelnuovo). Sur ce, un ordre du 5 Joumadah al-Awwal (25
septembre) fut envoyé pour que le Kapudan Bacha et les
Beylerbeyi d’Algérie hivernent à Kotor avec la flotte
impériale de 230 vaisseaux. Les provisions pour six mois
devaient être fournies pour la marine et la forteresse de
Nova. En outre, Ahmed Bacha, commandant des forces
terrestres, reçut l’ordre que les sipahis de Koumdia sous le
commandement du Beylerbeyi Huseyin devaient rapidement se
déplacer là où une attaque ennemie était attendue. Afin de
garder Nova, le Beg de Kjustendil fut envoyé. Les Begs
d’Herzégovine et de Shkoder devaient communiquer avec les
commandants et entrer en action en coopération avec eux. Le
7 Joumadah al-Awwal (27 septembre), Mustafa Chavoush
informa, de Delvina, l’arrivée de la flotte chrétienne près
de Corfou.
En septembre, Ahmed Bacha arriva en Albanie avec les
Beylerbeyi de Roumanie pour réprimer les rebelles albanais à
Ohrida et pour renforcer les garnisons des forteresses de
Preveza, Patras, Delvina, Avlona et Durazzo avec des
timariots sipahis (cavalerie provinciale). Il chargea les
Begs de Kjustendil et Vidin de garder la côte albanaise et
inspecta tous les points dangereux de cette région. Mahmoud
Ozkour oglu, apparemment un membre de la vieille famille
albanaise des Sagouras, offrit ses services pour garder les
côtes avec deux mille volontaires. Plus tard, Ahmed
Bacha écrivit à la Porte que les troupes étaient en mauvaise
posture en raison de la pluie et du manque de provisions en
Albanie, et ils insistèrent pour rentrer chez eux. Les Begs
gardant les côtes envoyèrent également des plaintes sur la
rareté des provisions, affirmant qu’il leur était impossible
de rester en Albanie pendant l’hiver. Dans un ordre du 20
Joumadah al-Oula (10 octobre), c’est-à-dire trois jours
après la bataille de Lépante, la Porte informa Ahmed
Bacha que la flotte chrétienne était à Corfou et qu’aucune
troupe ottomane ne devait partir pour leurs provinces
d’origine (les sipahis timariots servaient seulement pendant
la saison de campagne, c’est-à-dire du printemps à
l’automne), et que les troupes épuisées des navires devaient
être remplacées par des troupes fraîches des forces
terrestres. Il devait donner les contingents requis
d’urgence par la marine, inspecter les garnisons dans les
forteresses, puis se rendre avec toutes les forces sous son
commandement à un point proche de l’endroit où l’attaque
ennemie était attendue.
Vers la mi-Joumadah al-Oula (début d’octobre), la Porte
apprit que la flotte chrétienne sous le commandement de Don
Juan comprenait 130 galères, 70 frégates, 28 barches et six
maones.
Ne sachant pas qu’ils feraient face à une assemblée aussi
organisée de galères dirigée par les forces de la Papauté,
de Venise et des Habsbourg sous le drapeau du Saint Empire
romain, les Ottomans furent pris au dépourvu. La flotte
alliée comprenait plus de 200 navires dont l’effectif total
comptait environ 44000 marins, rameurs compris. En outre, il
y avait quelque 28000 soldats à bord. Ils étaient armés de
l’arquebuse, le précurseur du mousquet. En outre, la flotte
de la Sainte Ligue était suivie par un train de 24 cargos à
voile qui étaient là pour fournir un soutien logistique en
cas de besoin. La flotte ottomane, comptant environ 224
navires, succomba devant la flotte de la Sainte Ligue.
Quelque 194 navires ottomans furent coulés ou capturés par
l’alliance chrétienne. Le grand amiral fut tué, avec ses
fils, tandis qu’un autre commandant sauva sa propre vie en
s’enfuyant simplement. Le seul commandant, qui survécut à la
bataille fut ‘Oulouj ‘Ali Basha, plus expérimenté dans les
affaires maritimes que les deux autres commandants, qui
réussit à ramener à Istanbul un petit escadron de galères.
Le 29 de ce même mois (19 octobre) toujours non informé de
la défaite de Lépante, la Porte pensa que la campagne était
terminée et envoya la permission aux forces terrestres de
rentrer chez elles avec l’avertissement qu’elles devraient
être prêtes pour l’expédition du printemps prochain. Tous
ces faits confirment l’idée que la Porte ne s’attendait pas
sérieusement à une attaque ennemie à ce moment-là, et que la
bataille fut plutôt une surprise.
‘Ali, chroniqueur ottoman contemporain, déclara : « La
flotte navigua longtemps sur la mer. Personne n’apparut. Les
Ottomans crurent que les Chrétiens n’avaient pas le courage
de les rencontrer. L’hiver approchait. Les corsaires et les
Begs des provinces côtières demandèrent à la Porte la
permission de rentrer chez eux. Ainsi l’armée se désintégra.
» Lorsqu’on apprit que l’ennemi s’apprêtait à attaquer la
flotte ottomane, les commandants ottomans recrutèrent à la
hâte des équipages pour les navires parmi les garnisons des
forteresses côtières et même parmi la population locale.
Il n’y a pas de rapport ottoman détaillé disponible sur la
bataille d’Incirli Liman dans la baie de Lépante. Le rapport
de Bartawi Bacha, mentionné dans un firman, n’a pas encore
été découvert dans les archives turques. Les chroniques n’en
donnent qu’un très bref compte rendu. Le Sultan, alors à
Edirne (Andrinople), reçut des nouvelles de l’événement par
un émissaire spécial de ‘Oulouj ‘Ali Bacha le 3 Joumadah
ath-Thani (23 octobre) (selon Selaniki, quelques jours plus
tôt). Dans un firman daté du 8 Joumadah ath-Thani (28
octobre) envoyé à Bartawi Bacha, seul ce qui suit fut dit à
propos de l’événement : « Maintenant, une bataille peut être
gagnée ou perdue. Il était destiné à se passer ainsi selon
la volonté d’Allah. » En fait trop confiants après la chute
de Famagouste (Magosa) le 9 Rabi’ al-Awwal (1er août 1571)
qui acheva ainsi la conquête de Chypre et la prise des
forteresses vénitiennes de Dulcigno et d’Antivari en Albanie
pendant l’été, les Ottomans furent choqués par la nouvelle.
L’historien ottoman ‘Ali nota que depuis la création du
monde et la construction du premier navire par Nouh
(‘aleyhi salam), aucune catastrophe de ce type ne fut
enregistrée. Discutant des causes de la défaite, les
chroniqueurs ottomans soulignent le départ inhabituellement
précoce de la flotte d’Istanbul au printemps, l’épuisement
des équipages à la suite d’une longue période d’opérations
en mer, la désertion des timariots sipahis des navires,
l’attaque inattendue de la flotte chrétienne à un moment où
les Ottomans croyaient que la campagne était terminée,
l’ordre définitif initial de la Porte de rencontrer la
marine chrétienne et l’insistance du Kapudan Bacha à se
conformer à cette directive ; son mépris de la tactique de
combat de ‘Oulouj ‘Ali, sa précipitation dans les lignes
ennemies pendant que 40 ou 50 de ses navires étaient
retournés au rivage et la désertion de bon nombre de ses
troupes. Comme l’a dit un chroniqueur ottoman, « le grand
amiral de la marine ottomane n’avait jamais commandé une
seule barque de sa vie» et selon un autre chroniqueur « il
n’avait jamais assisté à une bataille navale et ni ne fut
informé de la science de la piraterie. » Mais tous les
chroniqueurs terminent en disant que c’était le plan d’Allah
pour mettre en garde les croyants musulmans contre leurs
péchés.
La réunion du Divan Impérial le lendemain de l’arrivée de
l’émissaire démontre un esprit et une confiance élevés dans
la remise en état des choses. Le registre
des
décisions du Divan contenait un certain nombre de mesures
énergiques après cette réunion: un ordre à Kilij (‘Oulouj)
‘Ali Bacha, Beylerbeyi d’Algérie et maintenant Kapudan
Bacha, qui sauva ses 20 navires à Lépante, pour rassembler
tous les navires éparpillés de la flotte et rester en garde
dans une ligne entre la Grèce et Scio ; un autre ordre à Ahmed
Bacha, le Beylerbeyi de Roumélie, pour recruter et placer
des soldats dans les forteresses sur les côtes, pour
surveiller et repousser l’ennemi s’il venait à terre, pour
inspecter la région de Préveza puis se déplacer vers la
Morée avec toutes les forces rassemblées pour y faire face à
toute attaque ennemie. On pensait que la Morée était en
grand danger car la marine avant la bataille avait embarqué
un grand nombre de soldats des forteresses et les Mainots
étaient en rébellion.
Le Sultan reprocha aux soldats qui avaient quitté leurs
positions avant la bataille en ces termes : « Il n’y a pas
eu de situation similaire auparavant. Il n’y a aucune excuse
pour dire que le terrain était accidenté alors qu’en dépit
de l’hiver, l’ennemi était en route pour détruire notre pays
et que leurs maux s’accumulaient chaque jour. Que vous
donniez de telles excuses montre simplement un manque de
zèle religieux et d’esprit civique de votre part. »
Le 4 Joumadah ath-Thani (24 octobre), de nouveaux ordres
furent envoyés à tous les qadis des côtes de la Méditerranée
pour placer des sentinelles aux points dangereux, pour
déplacer les populations locales vers des hauteurs
difficiles à atteindre, pour compléter ou augmenter les
garnisons des forteresses. Des ordres spéciaux furent
envoyés aux gardiens des châteaux du détroit, de Rhodes et
de Modon pour qu’ils soient armés et en alerte. Tout cela
montrait que la Porte envisageait sérieusement la
possibilité d’une attaque sur les côtes et même sur Istanbul
même. La Chypre nouvellement conquise était considérée comme
particulièrement vulnérable, surtout lorsque la nouvelle de
42 navires vénitiens se dirigeant vers la Crète arriva. Les
Beylerbeyi de Karaman et Begs des quatre provinces
anatoliennes à savoir Isel, Tarse, Alaiye et Teke,
maintenant tous incorporés dans la province de Qoubrous
(Chypre), avec toutes les forces sous leur commandement
reçurent l’ordre de passer immédiatement sur l’île. Les
capitaines de Paphos et de Kyrenia reçurent également
l’ordre de retourner à Chypre avec leurs navires.
Après avoir reçu Ahmed Bacha, le conquérant de
Dulcigno, et Lala Mustafa, le conquérant de Chypre, avec une
grande cérémonie en sa présence, le Sultan revint d’Edirne à
Istanbul le 4 Joumadah ath-Thani (28 octobre). Il eut,
dit-on, une sorte de mélancolie après que la nouvelle de «
la flotte vaincue » l’atteignit.
Au milieu de novembre, le Kapudan Bacha informa le Sultan de
sa venue à Istanbul avec la flotte. Nous savons que Don Juan
était déjà de retour à Messine le 1er novembre. Selon
Selaniki, un témoin oculaire, Kilij ‘Ali arriva à Istanbul
le 1 Sha’ban 979 de l’Hégire (19 décembre) avec 32 navires,
dont certains étaient apparemment ceux dispersés après la
défaite. Dès qu’il atteignit la capitale, il se rendit à
l’arsenal impérial pour superviser la construction de la
nouvelle flotte.
Le récit le plus détaillé de l’incident de Lépante et des
autres expéditions navales ottomanes se trouve dans
Touhfat al-Kibar fi
asfar al-Bihar (Les chefs d’œuvre des maitres dans les
expéditions en mer) de Kâtip Çelebi (Katib Chalabi) que nous
avons intégralement traduit et qui se trouve à la fin de
notre œuvre en appendice.
L’impact naval
L’engagement de la flotte ottomane avec la flotte de la
Sainte Ligue au large de Lépante le 7 octobre 1571 donna à
la flotte impériale ottomane sa première défaite majeure en
mer en Méditerranée. Cet événement est inscrit dans
l’histoire méditerranéenne comme la dernière grande bataille
de galères, marquant la fin des avirons longs et lourds et
le début des voiliers légers et rapides. Mais peut-être plus
important encore, cette dernière grande bataille de galères
mit également un terme à la communication entre le monde
ottoman et l’occident dans le domaine de la technologie
maritime. Les galères ottomanes qui furent opposées à celles
de leurs rivaux européens à Lépante furent jugées
insuffisantes particulièrement en ce qui concerne la
puissance de feu, et en conséquence la marine ottomane
entreprit immédiatement une mesure de restructuration dans
un effort pour conserver le contrôle de ses possessions en
Méditerranée.
L’arsenal impérial ottoman travailla à sa plus grande
capacité pour reconstruire la flotte impériale selon des
lignes quelque peu améliorées. En l’espace de 5 à 6 mois,
l’arsenal impérial ottoman acheva la construction de la
flotte, apportant tous les matériaux de construction et la
main-d’œuvre via une politique d’imposition sévère des
provinces. Tous ces navires étaient entièrement équipés
d’artillerie, de canons et d’autres instruments de guerre et
habités par des rameurs et des guerriers. Le fait que les
Ottomans aient reconstruit leur marine peu de temps après la
défaite peut être considéré comme un moyen d’affronter la
défaite et de surmonter ses effets à la fois. Cependant, les
grands sacrifices financiers consentis par la Porte pour
protéger l’empire en construisant une nouvelle flotte
marquèrent la fin de la puissance maritime ottomane. Andrew
Hess, prenant en considération les réalisations navales
ottomanes en Méditerranée après la défaite de Lépante,
affirme que la puissance maritime ottomane survécut à la
défaite.
Le succès éventuel de la campagne de Tunis (1569-1574) peut
être considéré comme un témoignage de la reprise rapide de
la marine ottomane de la désastreuse défaite navale et de la
restauration du contrôle ottoman sur les eaux orientales de
la Méditerranée. Cependant, les charges financières
introduites par la défaite écrasante et l’avènement des
Anglais et des Néerlandais sur la Méditerranée rendirent
impossible un rétablissement complet de la puissance
maritime ottomane. En fait, après l’achèvement de la
conquête de Tunis et de La Goulette, les affaires navales
ottomanes entrèrent dans une période d’inactivité jusqu’à
environ le milieu du XVIIe siècle, lorsque les Ottomans
montèrent une autre expédition majeure contre la Crète, la
dernière possession vénitienne dans la Méditerranée
orientale. Contrairement aux campagnes précédentes, la
campagne de Crète dura près de vingt-cinq ans pour s’achever
en 1669 avec la prise de Candie. À cet égard, la défaite de
Lépante peut être considérée comme une référence dans
l’histoire navale ottomane en ce qu’elle a mis fin à la
période de campagnes navales rapides que la marine ottomane
exécutait depuis les dernières années du XVe siècle.
La défaite de Lépante eut également un impact majeur sur la
politique ottomane dans l’océan Indien. Avant la défaite de
Lépante, les Ottomans avaient réussi à rétablir leur
domination sur le Yémen et Aden (1569-1570) et se
préparaient à lancer une attaque globale contre les
Portugais dans l’Océan Indien. Comme le note Inalcik, « si
les Ottomans n’avaient pas porté un coup terrible à leur
puissance navale à Lépante, ils auraient pu poursuivre leur
politique agressive dans l’Océan Indien, » ce qui implique
que les Ottomans, utilisant le Yémen comme base stratégique,
pourraient étendre leur autorité loin dans l’Océan Indien.
Cependant, la défaite de Lépante incita les Ottomans à
reconsidérer ces projets navals globaux et à les écarter
finalement en faveur de campagnes terrestres à grande
échelle.
Quant à l’impact immédiat de la défaite de Lépante sur la
situation politique en Méditerranée orientale, « il ne fait
que reconfirmer une impasse navale selon laquelle la
suprématie navale en Méditerranée orientale resta aux mains
des Musulmans tandis que la Méditerranée occidentale resta
majoritairement sous contrôle chrétien. » Comme le déclare
Ronald Jennings, « aucun des partis qui sont sortis
victorieux de Lépante n’occupa de territoire, n’obtint aucun
avantage stratégique ou ne put donner suite à ce succès
isolé. Les Ottomans dépouillèrent non seulement Venise de sa
possession la plus riche et la plus aisée, c’est-à-dire
Chypre, et de ses bases navales les plus importantes, mais
privèrent également les pirates latino-chrétiens de leur
base la plus importante. »
Conclusions
Le développement de la puissance maritime ottomane
reconfigura l’équilibre des pouvoirs du début du XVIe
siècle, qui aboutit à la subordination de la République
vénitienne. Une série de conquêtes navales, en commençant
par Lépante, Modon, Coron et Navarin à la fin du XVe siècle,
puis en poursuivant les conquêtes de Rhodes, Préveza et
Chypre tout au long du XVIe siècle, dépouilla les Vénitiens
de toutes les grandes zones commerciales qui étaient
essentielles pour leurs réseaux marchands dans le commerce
longue distance. Certes, les Vénitiens sortirent victorieux
de la confrontation de Lépante. Cependant, ils consommèrent
toute leur richesse pendant leurs guerres coûteuses avec les
Ottomans depuis 1570 ; ainsi ils acceptèrent un nouveau
traité avec les Ottomans en 1573, dans lequel ils
acceptèrent de céder toutes les forteresses qu’ils avaient
récemment conquit en Albanie et en Bosnie, de rendre tous
les prisonniers ottomans sans rançon, de limiter leur flotte
à 60 galères et payer 300000 ducats en réparations. Ainsi,
il ne serait pas faux de prétendre que la victoire de
Lépante ne porta aucun fruit et ne servit aucun but pour les
Vénitiens. La disparition progressive des Vénitiens du monde
commercial ottoman fut compensée dans un premier temps par
les marchands de Marseille et de Raguse. Cette évolution
encouragea l’Angleterre, jusqu’alors restée en dehors de la
périphérie du monde ottoman, à entrer directement en contact
commercial avec les Ottomans. Bien que les Anglais aient
célébré la défaite ottomane à Lépante avec des feux de joie
et « des banquets et de grandes réjouissances » car la
victoire des Vénitiens et des Espagnols était d’une « si
grande importance pour tout l’état du Commonwealth chrétien,
» l’intérêt de l’Angleterre pour les Ottomans continua à se
développer malgré le ressentiment personnel de certains rois
comme James I. James I, qui accéda au trône d’Angleterre en
1603, écrivit un poème sur Lépante en 1583. Il définit le
conflit comme un combat « Entre la race baptisée, / Et les
Turcs circoncis. » James I était connu pour son caractère
antimusulman et son anticatholicisme qui incita le
représentant anglais au Maroc à le pousser à entreprendre
une guerre contre ce pays. James I n’attaqua pas le Maroc
mais signa un traité de paix avec l’Espagne dans lequel
l’Espagne et l’Angleterre convinrent d’une résistance
commune des Turcs, l’ennemi commun de la Chrétienté.
Du côté ottoman, un tel intérêt n’était pas sans soutien.
Puisque les Ottomans voyaient la coalition papale
vénitienne-espagnole comme une formidable menace pour leur
existence même, leur intérêt à approcher les pays de l’Ouest
et du Nord devint une politique vitale après le désastre de
Lépante. L’approche ottomane de l’Angleterre alla jusqu’à
permettre aux pirates anglais d’utiliser les ports ottomans
en Afrique du Nord, en Albanie et en Morée, et dans certains
cas coopérer avec eux. Un an seulement après la défaite, le
Sultan Ottoman Salim II envoya un messager au roi de France,
offrant l’assistance de la flotte ottomane contre l’Espagne
et suggérant une attaque concertée de la France et de
l’Angleterre et des princes des Pays-Bas. Un autre résultat
majeur de la défaite fut ressenti sur la politique ottomane
traditionnelle d’étendre les privilèges capitulaires aux
nations occidentales en vue d’acquérir un allié au sein de
la chrétienté. Venise avait été neutralisée par de tels
privilèges commerciaux au cours du seizième siècle et
empêchée ainsi de mettre sa puissante marine au service des
papes en croisade.
En ce qui concerne la réaction précoce des dirigeants
politiques ottomans à la défaite de Lépante, ils n’étaient
pas préparés à une défaite aussi désastreuse, et donc
abasourdis par elle mais certainement pas submergés par ses
conséquences à court terme. Ils travaillèrent pour annuler
ses effets potentiels à long terme en mobilisant toutes
leurs ressources pour reconstruire la flotte dans une
période de cinq mois. Ici, la crainte de nouvelles attaques
de la flotte alliée victorieuse sur de nouvelles cibles
ottomanes, y compris la capitale, dû inciter les dirigeants
politiques à consacrer toutes leurs ressources et énergies à
reconstruire la flotte en si peu de temps. Du point de vue
naval, la reconstruction de la flotte ottomane sur une
période de cinq mois démontre la résilience de l’État
Ottoman face à un tel incident. Le lancement de nouvelles
expéditions à La Goulette et Tunis et les conquêtes réussies
de ces lieux témoignent de la récupération rapide de la
puissance maritime ottomane des effets d’un événement aussi
tragique. La préoccupation de la direction politique au
sujet de l’opinion publique en général devrait également
être reconnue pour expliquer la reprise rapide de la
défaite. De grandes festivités et processions furent
organisées pour fêter l’achèvement de la construction de la
nouvelle flotte en vue d’influencer l’opinion publique.
Quant à l’effet de la défaite sur les activités militaires
ottomanes, la défaite incita les Ottomans à reconsidérer
leurs projets navals mais elle n’eut guère d’effet sur la
politique ottomane d’expansionnisme. Au contraire,
l’événement accrut le zèle ottoman alors que l’armée
ottomane intensifiait ses activités vers l’Europe centrale à
l’ouest et l’Iran à l’est.
Quelle fut donc l’importance de la défaite de Lépante pour
les Ottomans ? La meilleure réponse à cette question est
offerte par Ronald Jennings, qui déclare que « probablement
le commandant ottoman à Lépante manquait de détermination et
de résolution, ce pour quoi il fut renvoyé, mais se
souvenant de la longue succession ininterrompue de
militaires et de victoires navales, qui avaient été obtenues
au siècle précédent, le succès à Chypre à ce moment-là, et
les succès qui se produiraient pour la prochaine décennie ou
plus, il est difficile de juger la défaite de Lépante comme
décisive de quelque manière que ce soit, même comme un
présage de malheur qui pourrait suivre plus tard. Il semble
évident que la conquête de Chypre était bien plus importante
que la bataille de Lépante. »
Ceci est mieux attesté par une conversation entre le Grand
Vizir ottoman Sokullu Mehmed Basha et l’ambassadeur
vénitien Barbaro à Istanbul qui ne fut pas autorisé à
retourner à Venise pendant la campagne de Chypre et
l’incident suivant de Lépante. Lorsque l’ambassadeur
vénitien interrogea Sokullu sur les plans ottomans après la
défaite de Lépante, Sokullu aurait déclaré : « Comme vous
l’avez observé, notre courage ne s’est pas évanoui après la
bataille de Lépante ; il y a un écart entre vos pertes et
les nôtres. » Nous vous avons cédé une terre (en référence à
Chypre) où vous pouvez construire un royaume et coupé ainsi
un de vos bras. (Alors que) vous avez vaincu notre flotte,
ce qui ne signifiait rien de plus que de nous raser la
barbe. Un bras manquant ne peut pas être remplacé mais une
barbe rasée s’épaissit. »
Le seul impact majeur de la défaite de Lépante fut sur les
populations fiscales de l’Empire. La longue période de
guerre navale qui aboutit à la campagne de Lépante imposa
des charges financières constantes à la paysannerie, en
particulier à celles vivant dans les provinces maritimes, ce
qui contribua énormément à leur mécontentement à l’égard des
autorités centrales et provinciales. Le fait qu’après la
défaite, les Ottomans se soient sentis obligés de maintenir
une flotte puissante en Méditerranée comme contrepoids à la
flotte alliée ne faisait qu’ajouter à la pression
financière. Ainsi, la défaite de Lépante n’a pas été la
cause principale mais l’un des facteurs qui ont accéléré le
mécontentement, qui s’est transformé en l’un des mouvements
sociaux les plus importants de l’histoire ottomane.
Enfin, en ce qui concerne l’impact de la défaite sur la
perception ottomane de l’Europe, en particulier leur
sentiment de supériorité, la défaite n’a pas eu d’effet
majeur. Si nous avons besoin d’identifier un événement qui
marqua la fin du complexe de supériorité de la part des
Ottomans vers l’Europe, ce fut plus l’échec du deuxième
siège de Vienne contre une armée combinée
Habsbourg-polonaise en 1683 que la bataille de Lépante. La
défaite aux portes de Vienne ouvrit la voie à une série de
Traités de paix humiliants qui se succédèrent. Le Traité de
Karlowitz en 1699 marqua le début de la longue et lente
retraite des Ottomans de leurs conquêtes européennes. À la
fin du XVIIIe siècle, l’Europe, en particulier l’Europe
occidentale, avec sa révolution militaire et sa technologie
navale supérieure, n’était plus vulnérable à la puissance
ottomane autrefois considérée comme invincible. Par
conséquent, à mesure que l’Empire Ottoman devenait
politiquement et économiquement dépendant de l’Europe, il
commença à s’adapter au défi de la supériorité occidentale.
De même les Sultans de l’époque étaient loin de ressembler
aux Sultans conquéreurs de la première heure.
Notre dernier mot est que lorsqu’il s’agit de victoires
contre l’Islam et les Musulmans, même lorsqu’elles sont de
peu d’importance voir insignifiantes, elles engendrent
instantanément un tsunami d’éloges et de pamoisons largement
exagérées qui semble ne jamais cesser même après des
millénaires cependant, quand il s’agit de défaites c’est
tout le contraire. Les victoires de l’Islam et des Musulmans
sont vites étouffées sous le folklore des ghouls et des
succubes, des mouches tsé tsé et des apostats chrétiens et
autres mercenaires fantoches. Fiers dans la victoire et
mauvaises foi dans la défaite !
|

