
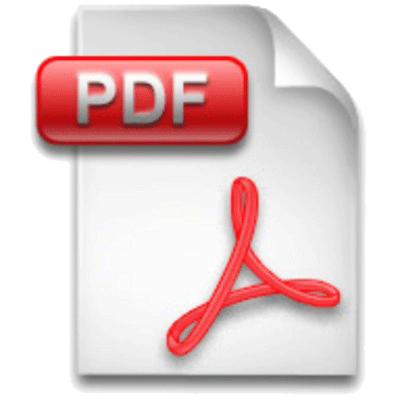 |
La conquête d’Akcha-Hisar (Croia)
La forteresse d’Akcha-Hisar était encore plus
résistante qu’Iskandariye.
Les Albanais s’étaient rebellés contre les Ottomans surtout
parce qu’ils avaient confiance en l’invulnérabilité de cette
forteresse. Elle avait été assiégée pendant six mois par le
Sultan Mourad, qui avait finalement renoncé à la tentative
sans lancer un dernier assaut. Le Sultan Muhammad
prit tout d’abord le contrôle de toutes les routes maritimes
et terrestres par lesquelles les approvisionnements ou les
renforts pouvaient atteindre la forteresse et prévoya de
l’assiéger et de la prendre.
À son retour d’Iskandariye, il marcha sur Akcha-Hisar.
Les défenseurs de la forteresse demandèrent quartier mais
lorsqu’il devint clair qu’ils s’étaient rendus à cause du
manque de provisions, le Sultan ordonna que les défenseurs
de la forteresse soient passé par l’épée.
La Mission de Ahmed Kadik à Pouilles et l’expédition de Massih Bacha à Rhodes
Tout ce que le Sultan s’était efforcé de réaliser pendant
son règne se réalisa grâce à l’aide de d’Allah Exalté.
En l’an 884 (1479), il resta dans sa capitale et envoya des
armées dans diverses régions. Il envoyé Ahmed Bacha
Kadik avec une grande flotte à Boulya (Pouilles) où il
captura la forteresse et converti les églises en mosquées.
En 855 (1480), Massih Bacha attaqua Rhodes avec une
grande flotte et assiégea la forteresse. L’île fut subjuguée
et pillée après de violents combats puis Massih Bacha
retourna dans la capitale.
Les plans de Fatih pour la conquête de la Syrie et de l’Égypte
Bien que Fatih paraissait inactif, il se préparait en
fait à une nouvelle grande entreprise. Au printemps 886 de
l’Hégire (1481), il envoya aux provinces des ordres pour que
les troupes se préparent pour une campagne lointaine. Il
devint vite clair que la campagne devait être du côté
anatolien de l’empire, mais personne ne savait si elle était
contre l’Iran ou l’Arabie. Fatih traversa le Bosphore
jusqu’à la côte anatolienne le 27 Safar 886 (27 avril 1481)
et installa son camp. Lorsqu’il quitta son palais et
traversa le Bosphore, sa maladie de longue date s’aggrava.
La mort du Sultan Muhammad
Lorsque le camp impérial fut installé dans un endroit appelé
Takfour-Qaym, la maladie du Sultan s’aggrava et le jeudi 4
Rabi’ Awwal 886 (3 mai 1481), il décéda, puisse Allah Exalté
lui faire miséricorde. Dès que le Sultan décéda, l’armée
permanente et la maisonnée le chassèrent comme d’habitude de
leur esprit et commencèrent à penser qui serait le prochain
Sultan.
La situation pendant l’Interrègne et l’ascension de Bayazid
Afin d’éviter tout désordre jusqu’à l’arrivée du Sultan
Bayazid de l’Eyalet de Roum, les responsables de l’état
décidèrent de donner des pouvoirs temporaires à Korkoud, le
fils de Bayazid, alors présent dans la capitale. Les troupes
du Sultan furent ostensiblement envoyées pour garder
Korkoud, mais en fait il protégeait le trône de son père.
Par la suite, la situation se calma.
Le règne du Sultan Bayazid
Lorsque le Sultan Bayazid atteignit la région de Bolu,
quelques Vizirs, Begs et hauts officiers de l’armée
permanente allèrent à sa rencontre puis quand il arriva près
d’Istanbul, tous les janissaires et la maison du Sultan
sortirent et promirent leur allégeance au nouveau Sultan. Le
Sultan les déploya à sa droite et à sa gauche et entra dans
Istanbul en toute majesté le 22 Rabi’ Awwal 866 (21 mai
1481) pour prendre sa place sur le trône.
Des ambassadeurs vinrent de partout, d’Arabie, d’Iran,
d’Europe, de Hongrie et de toutes les nations, pour le
féliciter. Parmi eux, seul l’ambassadeur égyptien ne fut pas
bien accueilli par le nouveau Sultan.
La raison de la froideur du Sultan était l’ingérence des
Égyptiens dans les missions de bonne volonté envoyées par le
dirigeant indien au père de Bayazid, le Sultan Muhammad.
Les Indous avaient envoyé une mission avec de précieux
cadeaux à Fatih. En retour, Fatih avait envoyé
le Seyh Efdal ad-Din-oglu Muhammad Chalabi comme
ambassadeur en Inde. A son retour de l’Inde, l’ambassadeur
indien accompagna Muhammad Chalabi et ensembles, ils
se rendirent au port de Jiddah chargés de cadeaux précieux
pour le souverain ottoman. À ce moment-là, la nouvelle de la
mort de Fatih et de l’accession de Bayazid atteignit
l’Arabie et l’Iran.
Le Sultan d’Egypte retint les deux ambassadeurs, confisqua
leurs biens et, en somme, ne montra pas le respect qui
s’imposait au Sultan Bayazid, chose qu’il n’oubliera pas de
sitôt. L’ambassadeur égyptien était venu demander pardon
pour la détention de la mission indienne et restituer les
biens saisis, mais ses excuses ne furent pas acceptées par
le Sultan.
La conquête d’Ak-Kerman et Kili (Kilia)
La Moldavie, en raison de son incapacité à respecter les
conditions de sa reconnaissance de la suzeraineté ottomane
et de sa négligence à payer le tribut, méritait une forme de
punition. Au printemps 889 de l’Hégire (1484), le Sultan
partit par voie terrestre avec son armée tandis que la
flotte procédait par mer avec des provisions et des forces
navales.
Lorsque l’armée atteignit le Danube, un pont fut construit
par lequel le Sultan et son armée passèrent de l’autre côté.
Il marcha sur la forteresse de Kili, que feu le Sultan Muhammad
n’avait pu assiéger et commença à bombarder ses murs avec
des catapultes et des canons. Ceux du château demandèrent
quartier et se soumirent aux Ottomans.
Après avoir ainsi facilement maîtrisé Kili, l’armée se
dirigea vers Ak-Kerman, port prospère en raison de son rôle
de point de passage des marchands de Kefe, de Russie, de la
steppe ukrainienne (Dest), de Pologne et de Hongrie. Le fort
fut complètement encerclé et ils commencèrent à marteler ses
murs avec des coups de canon. L’ennemi rendit volontairement
la forteresse après quatre ou cinq jours et fut donc gracié
par le Sultan. Le prince de Moldavie s’enfuit en Pologne et
son pays fut ainsi laissé vide et sans défense contre les
ghazis ottomans qui attaquèrent dans tous les sens, faisant
de nombreux prisonniers et un butin abondant.
Des qoudat et des sancak furent assignés et les deux
forteresses furent intégrées aux terres de l’Islam.
Hormis Yildirim Bayazid Khan, aucun Sultan Ottoman n’avait
remporté une victoire aussi remarquable sur ces terres. On
dit que Yildirim nomma pour une courte période un qadi sur
le territoire hongrois à Pragova. Après cette
impressionnante victoire, la Pologne, la Bohême et la
Hongrie craignirent tous l’avancée ottomane et se soucièrent
de la sécurité de leur propre pays. Le Sultan ordonna
également des raids contre leurs pays. Beaucoup de leurs
forts et forteresses furent capturés et un butin important
pris. Le Sultan retourna alors à Edirne.
La campagne contre les Mamelouks et la campagne moldave de ‘Ali Bacha
Au printemps 890 (1485) de l’Hégire, le Sultan envoya
Karakoz Bek, qui était le gouverneur-tuteur du prince
Shahinshah à Karaman, à la tête d’une armée renforcée par un
contingent de l’armée du Sultan pour faire campagne en
Arabie. Sur son chemin, Karakoz prit Adana, Tarse, Koulak,
Alankoush et d’autres forteresses et réduit à la soumission
les tribus turkmènes de Khoush-Timourlou, Kosounlou et
Kara-Isalou.
Cette même année, le prince moldave lanca une attaque contre
Kili. Le Sultan envoya donc ‘Ali Bacha, alors le Beylerbeyi
de Roumélie, avec un contingent de l’armée régulière dans la
capitale pour le punir. ‘Ali Bacha traversa le Danube avec
l’aide de la flotte qui y attendait. Selon les ordres, il
fortifia d’abord Kili, puis marcha sur la Moldavie. Le
prince de Moldavie ne put résister à son assaut et se retira
dans une région montagneuse. Profitant de son absence, ‘Ali
Bacha donna aux troupes la permission de piller, et de
nombreux prisonniers et beaucoup de butin furent saisis. La
capitale du prince et son palais furent également incendiés.
Après cette victoire, ‘Ali Bacha revint au côté du Sultan
qui le nomma Vizir en retour de ses services.
Pour affronter le problème mamelouk, il fallait que le
Sultan entreprenne lui-même une campagne contre eux, comme
ses ancêtres l’avaient fait avant lui, mais Bayazid pensait
qu’il était en dessous de sa dignité de commander
personnellement une armée contre ces Sultans circassiens.
Contre ces Sultans esclaves, il envoya ses propres esclaves.
Indépendamment de son souhait de ne pas y aller, de grandes
batailles eurent lieu.
Au printemps 893 (1488), il envoya ‘Ali Bacha contre les
Mamalik ; Ahmed Bacha Hersek-zade fut envoyé à la
tête d’une grande flotte. Dans cette flotte se rassemblèrent
des navires à larges côtés tels que le mavuna et le ko’ke
avec des galères rapides et d’autres navires plus petits.
Les navires étaient chargés de canons, de mortiers, d’autres
armes et la logistique de guerre. ‘Ali Bacha ne fut pas
intercepté par l’ennemi lorsqu’il entra en territoire
mamelouk.
Adana et Tarse furent de nouveau fortifiés et cinq ou six
autres forteresses, dont Sis, furent prises. Pendant ce
temps, Ahmed Bacha Hersek-zade arriva par la mer et
captura la forteresse d’Ayas lors de pillages et de raids
dans la région autour de Tarablous.
En raison du travail acharné dans la construction de
forteresses et du climat insalubre dans la région, les
soldats et les animaux furent épuisés. Lorsqu’ils furent
consultés, certains des commandants pensèrent qu’il valait
mieux faire demi-tour, mais ‘Ali Bacha décida de livrer
bataille. Sur le champ de bataille, les Mamalik attaquèrent
les deux flancs de l’armée ottomane. En raison de leur
épuisement, les soldats ottomans ne purent repousser
l’attaque. Les Mamalik
attaquèrent alors le centre des rangs ottomans qui
était sous le commandement de ‘Ali Bacha. Cette fois, ‘Ali
les repoussa et, se retournant contre la force qui avait
attaqué ses deux flancs, les encercla et les passa par
l’épée. À la tombée de la nuit, les Ottomans se retirèrent
et leur train de ravitaillement fut attaqué par les Varsaks.
Il fut donc décidé de retourner en direction de Karaman en
raison d’un manque d’approvisionnement suffisant. Les
troupes furent renvoyées à leur arrivée à Karaman, et ‘Ali
Bacha retourna aux côtés du Sultan. Suite à cette bataille,
les Mamalik approchèrent les Ottomans avec des propositions
de paix. »
Fin de Tarikh Abou al-Fath
Ce n’est pas en vain que nous nous attardons sur la
Biographie de Muhammad al-Fatih puisque c’est
vraiment un exemple à suivre. Suivent donc plusieurs autres
textes.
Il serait intéressant de voir le sujet du côté des
occidentaux et la politique réelle derrière les biographies,
un éternel conflit entre le Chrétienté et l’Islam. Bien que
nous avons rapporté cela de manière détaillée dans notre
Introduction à
l’Histoire des Ottomans, j’ai choisi un document
intéressant du fait qu’il confirme la tentative des Mamalik
et des shiites de s’allier une nouvelle fois aux chrétiens
pour détruire les Ottomans ainsi que la tentative de la
prise de la Mecque et de Médine par les Chrétiens. Il est
aussi intéressant du fait qu’il fait la jonction entre les
deux Sultans Muhammad al-Fatih et Bayazid II.
Puisque mes ouvrages ne sont pas conventionnels et ne
suivent pas les protocoles habituels, je n’ai rapporté
aucune des sources mentionnées dans le texte qui suit
cependant vous pouvez les trouver dans le texte original[1]
et qui n’est pas de source musulmane, comme le titre
l’indique.
Les Turcs Ottomans et les Croisades, 1451-1522 Muhammad le Conquéreur d’Empire, 1451-1481
Pendant le siège proprement dit, qui dura cinquante-quatre
jours (du 6 avril au 29 mai), ces points de vue opposés
allaient revenir au premier plan à deux moments critiques.
Le résultat du siège dépendait en grande partie du facteur
temps. Tant les Byzantins que les Ottomans furent influencés
tout au long du siège par des rumeurs sur l’approche des
forces terrestres ou navales pour aider la ville. Dans la
dernière semaine de mai, le mot que Jean Hunyadi avait
traversé le Danube et qu’une flotte de croisés s’était mise
en route pour le Bosphore se répandit parmi l’armée
ottomane. Ces rumeurs et les tentatives du Sultan pour
obtenir la reddition de la ville par des offres de paix
engendrèrent des inquiétudes et des troubles parmi les
troupes ottomanes, qui critiquèrent le jeune Muhammad
pour avoir « exposé son peuple et l’état à la destruction
totale en s’engageant dans une entreprise dont
l’accomplissement était impossible. » Dans le conseil de
guerre qui fut alors convoqué, Chandarli attira de nouveau
l’attention sur les dangers qu’impliquait la provocation du
monde occidental et souligna la nécessité de mettre fin à
cette dangereuse guerre en parvenant à une sorte d’entente
avec les Byzantins. Les arguments de Chandarli furent
contrés par Zaganos, qui déclara sa conviction que les
dirigeants chrétiens échoueraient, comme par le passé, à
s’unir pour une action commune, et que même s’ils étaient
capables d’une manière ou d’une autre de déployer une armée,
les forces ottomanes supérieures étaient égales à leur défi.
Sur ce, la décision fut prise de lancer une attaque générale
le 29 mai, et il fut laissé à Zaganos le soin d’organiser
l’attaque. Le Sultan proclama en ces termes : « Les pierres
[les bâtiments] et le terrain de la ville et ses dépendances
m’appartiennent ; tous les autres biens et biens,
prisonniers et denrées alimentaires sont un butin pour les
troupes. Trois jours de sac ont été accordés. »
Dans ses plans pour construire un empire « universel, » Muhammad
apprécia pleinement la signification stratégique du détroit
en tant que contrôle de la puissance maritime vénitienne. Au
cours de son règne de trente ans, il créa une série de
lignes de défense de Ténédos à la Mer Noire pour rendre
Istanbul invulnérable de la mer. Avec des bases à Gallipoli,
Izmit (Nicomédie) et Istanbul, et protégée par ces solides
défenses, sa marine renforcée devint un véritable défi pour
la puissance navale vénitienne et un instrument efficace
dans la construction de son empire. En 1454, Muhammad
envoya sa marine, cinquante navires en tout, dans la Mer
Noire pour y contraindre la soumission des états et des
colonies. La marine attaqua d’abord Akkerman, forçant la
soumission, le 5 octobre 1455, de Pierre III Aron, voïvode
de Moldavie, au Sultan avec un tribut annuel de 2000 ducats
d’or.
La chute de Constantinople fut considérée comme un désastre
majeur en Occident et suscita une forte réaction dans toute
l’Europe. Le Pape Nicolas V (1447-1455) réussit à établir la
paix et une ligue entre les États Italiens en 1454, et
invita tous les gouvernements d’Europe à préparer une
croisade. Il ne fait aucun doute que la cour ottomane était
bien informée de ces initiatives. Muhammad agit
rapidement pour signer un traité avec Venise le 18 avril
1454, afin de neutraliser la République et de s’assurer
qu’elle ne fournirait pas l’appui naval dont dépendait si
fortement le succès des plans des croisés. Venise, pour sa
part, bénéficia du traité, qui reconnaissait ses privilèges
commerciaux au sein de l’Empire Ottoman, avec seulement un
droit de douane minimal de deux pour cent pour les
marchandises entrant et sortant de l’Empire. La République
conserva également le droit de maintenir un ambassadeur à
Istanbul en tant que représentant permanent à la Porte pour
défendre les intérêts vénitiens. En acceptant de payer un
tribut à leurs colonies de la Mer Noire et de la Mer Égée,
les Génois conclurent également un accord avec le Sultan.
Cependant, les Chevaliers Hospitaliers de Rhodes, sur ordre
direct du Pape, annoncèrent qu’ils ne paieraient jamais de
tribut annuel. Une campagne navale ottomane de 1454 dans la
Mer Égée sous le commandement de Hamza Beg accomplit peu.
Malgré la paix obtenue en Italie par le traité de Lodi le 9
avril 1454 et la conclusion d’une alliance défensive et
agressive contre les Ottomans pendant une période de
vingt-cinq ans entre les puissances italiennes le 25 février
1455, des hommes d’état réalistes tels que Francis Sforza,
Duc de Milan (1450-1466), Cosme de Medici de Florence
(1434-1464) et Alfonso I de Naples (1442-1458) n’étaient pas
convaincus par les rapports exagérés d’une imminente
invasion ottomane. En dehors de l’Italie, dans l’Europe
chrétienne, on retrouve la même indifférence à l’appel du
Pape à la croisade. Alors que Venise et la papauté voulaient
accroître le zèle des croisades à leurs propres fins, ces
potentats considéraient froidement la menace ottomane comme
un frein aux ambitions de leurs puissants rivaux en Italie.
Leur indifférence intrigua les historiens modernes, mais en
réalité une invasion ottomane de l’Italie en 1453 n’était
qu’une possibilité lointaine, compte tenu du fait que les
puissances chrétiennes, principalement Venise et Aragon,
avaient une nette supériorité navale dans le Méditerranée.
En outre, les avant-postes chrétiens en Albanie, dans la
Morée et dans la Mer Égée posaient un sérieux obstacle à
toute avancée ottomane. La Hongrie, qui menaçait les
Ottomans en Serbie, était également devenue la principale
préoccupation de Muhammad à cette époque.
[1]
The impact of the Crusades on Europe (A History of
the Crusades, volume, VI).
Chap IX: The Ottoman Turks and the Crusades,
1451-1522. M Kenneth Setton.
|

