
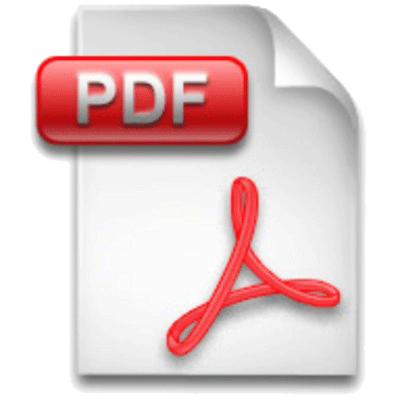 |

La Fondation de l’État Seljouk de Roum
L’État Seljouk de Roum fut fondé après et à cause du
déplacement d’un grand nombre de tribus turcomanes en
Anatolie. Mais le fondateur de cet état, Souleyman Ibn
Qoutalmish (petit-fils de Seljouk et fils d’Arsalan Yabghou)
ne faisait pas partie des commandants envoyés à la conquête
de l’Anatolie par Alp Arsalan après la victoire de
Manzikert.
En effet, parmi les conquérants mentionnés par les sources
ultérieures comme fondateurs de l’état, seul Artouk Bey peut
être vérifié. En 464 (1072), Artouk Bey vainquit une armée
byzantine commandée par Isaac Comnènes, le faisant
prisonnier, puis se rendit sur les rives du Sakarya,
laissant derrière lui l’Anatolie centrale. Lorsque la
rébellion de Jean Doukas créa une situation plus dangereuse,
l’Empereur conclut un accord avec Artouk et demanda son
aide. De cette façon, les Turcs atteignirent la baie
d’Izmit.
En raison de la lutte pour la succession après la mort d’Alp
Arsalan, Artouk Bey fut rappelé à Rayy, la capitale du Grand
Empire Seljouk, et aida Malik Shah à vaincre son oncle.
Des événements tels que la campagne de Souleyman en
Anatolie, la mort d’Alp Arsalan, le retour d’Artouk dans la
capitale et la lutte pour la succession au trône sont
étroitement liés. Lorsque Qoutalmish fut vaincu et tué en
456 (1064), à la fin de son combat pour le trône contre Alp
Arsalan, ses fils furent bannis aux frontières byzantines.
Ces prince rouges (ou fils de princes) sans aucun pouvoir
commencèrent à organiser les Turcomans d’Anatolie autour
d’eux après le départ d’Artouk Bey. Et certains de ces
Turcomans n’étaient autres que les Yabghoulou (Yavkiyya,
Yavgiyan), les tribus qui se rebellèrent contre Toughroul
Bek et Alp Arsalan et s’enfuirent en Anatolie. (Ce nom, qui
est utilisé pour les Turcomans rebelles qui étaient les
adeptes d’Arsalan Yabghou, fut confondu avec celui de la
tribu Yiva.) Ils avaient maintenant besoin d’un prince
Seljouk pour les diriger.
La première apparition authentifiée sur la scène des fils de
Qoutalmish remonte en 467 de l’Hégire (1074), alors qu’ils
étaient impliqués dans une bataille en Syrie contre Atsiz,
le bey Turcoman (Yavkiyya), qui avait accepté le service
sous Malik Shah, et aussi quand ils essayèrent d’établir des
relations avec le calife ‘oubaydi en Egypte. Après avoir
échoué à gagner cette bataille, Souleyman entra en Anatolie,
après avoir assiégé Alep et Antioche sur son chemin. Il
reprit ensuite Konya et sa région à ses dirigeants grecs,
conquit Iznik (Nicée) sans aucune résistance et la proclama
sa capitale en 467 (1075). Il est également probable que
Toutaq (Touqaq), qui avait marché jusqu’à Bithynie à la tête
de 100000 hommes après le retour d’Artouk, le rejoignit
également.
L’Empire Byzantin était dans un tel état et ses relations
avec l’Anatolie aussi coupées, que la conquête d’une ville
comme Iznik, qui joua un rôle important dans l’histoire du
Christianisme et qui était très près de Constantinople,
passa inaperçue dans les sources byzantines. Elle ne fut
mentionnée qu’à l’occasion de la succession de Nicéphore III
Botaniatès en 500 (1078), comme appartenant à Souleyman, ce
qui montre que la conquête dut avoir eu lieu avant cette
date. Ceci est confirmé par la déclaration de certains
auteurs musulmans qui, malgré la distance, Iznik fut
conquise par Souleyman en 467 (1075) et non pas 1077, 1078,
1080 et 1081 comme il a été rapporté.
Quand son arrière-petit-fils Seljouk fonda un état
dans cette terre nouvellement conquise, les Turcomans
anatoliens acceptèrent sa souveraineté et les tribus nomades
qui en entendirent parler émigrèrent sur cette terre en plus
grand nombre. Il y a un lien entre la grande migration de
1080 et la fondation de cet état.
En février 1074, l’Empereur Michel VII fit appel au Pape
Grégoire VII pour obtenir de l’aide, et en retour promit
l’unification de l’Église orthodoxe avec l’Église
catholique. Le Pape salua cette approche et convoqua
certains rois européens et toute la chrétienté à une
croisade contre les Turcs, qui avaient conquis les
territoires de l’Empire Byzantin jusqu’aux murs de
Constantinople. Mais le conflit entre la papauté et le Saint
Empire romain retarda l’organisation de la croisade pendant
vingt ans. Lorsque l’Empereur désespéra de toute aide de
l’Europe en 1074, il envoya un ambassadeur avec des cadeaux
inestimables à Malik Shah, mais toutes ces tentatives
n’eurent aucun résultat pratique.
Souleyman accrut le pouvoir de son état en intervenant dans
les conflits dynastiques à Constantinople et en aidant la
succession de Nicéphore III Botaniatès au trône. Il élargit
ainsi ses frontières et son armée établit son quartier
général à Usküdar (Chrysopolis) en 471 (1078).
Plus tard, en soutenant Nicéphore Mélissène, il annexa les
parties de Phrygie et d’Anatolie occidentale qu’il n’avait
pas encore conquises. En 473 (1080), les Seljouk vainquirent
une armée byzantine envoyée vers Iznik en 1080 et se
retranchèrent sur la rive asiatique du Bosphore, où ils
établirent des douanes et commencèrent à contrôler la
navigation.
Comme ils n’avaient pas de flotte, la mer les empêchait
d’attaquer Constantinople. Quand Alexis Ier Comnène devint
empereur en 1081, la première chose qu’il fit fut de faire
la paix avec Souleyman afin de défendre les Balkans contre
les peuples chamaniques turcs au nord du Danube. Ce traité
permit au Sultan Seljouk d’étendre son pouvoir à l’est.
Alors que la domination byzantine était en déclin en
Anatolie, un certain nombre de dirigeants arméniens
apparurent sur les rives de l’Euphrate et en Cilicie. L’un
de ces Arméniens, appelé Philarètes, soutenu par le
gouverneur de Malatya, Gabriel, coupa les communications
entre l’Anatolie et les pays musulmans de l’est et du sud.
En 475 (1082), Souleyman marcha vers l’est et, en conquérant
Adana, Tarse, Massissah et Anazarba en 476 (1083), établit
son contrôle sur toute la Cilicie. Pour sauver son royaume,
Philarètes se rendit chez Malik Shah, et adopta l’Islam ; la
population chrétienne d’Antioche, pour échapper à sa
tyrannie, invita secrètement Souleyman le 15 Sha’ban 477 (17
décembre 1084) et lui céda la ville. A cause de cette
conquête, il se disputa avec l’émir musulman ‘Ouqayli,
Sharaf ad-Dawlah, vainquit son armée et le tua (478/1085).
En raison de sa politique expansionniste et du siège d’Alep,
Souleyman dû se battre contre le frère de Malik Shah,
Toutoush, le gouverneur de Damas, et perdit la vie et son
armée le 20 Safar 479 (6 juin 1086).
En dix ans, Souleyman ne conquit seulement pas un vaste
territoire. Les Arméniens, les Chrétiens syriens et les
hérétiques pauliciens, qui détestaient la pression
religieuse et la politique d’assimilation de Byzance,
trouvèrent sous l’administration de Souleyman la liberté
religieuse qu’ils recherchaient. Grâce à la liberté
religieuse typiquement turque et à une administration juste,
pleinement appliquée par les successeurs de Souleyman,
l’État Seljouk gagna la loyauté de la population locale et
se renforca.
Le calife abbasside reconnut le Sultanat de Souleyman en
envoyant les emblèmes appropriés, comme une robe d’honneur,
un diplôme et un étendard. Il devint ainsi Souleyman-Shah et
cet état-frontière des ghazi (combattants dans la voie
d’Allah Exalté, moujahid, pluriel moujahidine) fut sauvé de
l’influence chiite. Néanmoins, dès 467 (1074), en opposition
à ses cousins en Perse, il communiqua avec le calife
‘oubaydi
en Egypte ; et, après avoir conquis Tarse, il n’hésita pas à
demander au chef chiite de Tripoli en Syrie, de lui trouver
des juges et des officiers religieux.
A ce propos, il convient de souligner que l’opinion qui
prétend que Souleyman fut envoyé en Anatolie par Malik Shah
et déclaré son dirigeant, n’est qu’un mythe. Il en est de
même des sources byzantines qui, de manière caractéristique,
le dépeignent comme un vassal de l’empire, alors qu’en fait,
il tint leurs Empereurs à sa merci.
L’Anatolie après Souleyman
Après la mort de Souleyman, ses fils qui étaient avec lui
furent envoyés à Malik Shah ; pendant un certain temps,
entre 479-85 (1086-92), le trône d’Iznik fut vacant et
l’unité politique de l’Anatolie brisée. En 477 de l’Hégire
(1084), le fondateur de l’État Danishmand central, Ghazi Ibn
Danishmand ou Danishmand Koumoushtakin Ahmad Ibn ‘Ali
Taylou at-Tourkman, en tant que vassal de Souleyman et
complétant les opérations de ce dernier, attaqua Gabriel, le
gouverneur de Malatya.
En 478 (1085), le conquérant de Chankiri et Kastamonou,
Qaratakin, prit Sinop et, la même année, l’émir Bouldaji
envahit les régions supérieures du Jayhan. Une autre
principauté, fondée par Menqouchek Ghazi entre Erzinjan et
Divriği, combattit les Grecs sur la rive de la Mer Noire en
collaboration avec les Danishmand.
Il y eut aussi un autre état fondé à Izmir (Smyrne) par un
bey turc courageux et intelligent nommé Chaka qui avait été
fait prisonnier par les Byzantins dans l’une des batailles
anatoliennes et instruit dans le palais impérial. En 474
(1081), il s’enfuit à Izmir et rassembla tous les Turcs de
ces régions sous son commandement. Il réussit également à
créer une marine en recrutant des Grecs sur les côtes, et
put ainsi asseoir son pouvoir sur les îles de la Mer Égée.
Cet état dura jusqu’à la fin de la première croisade.
L’une des autres premières principautés apparues en Anatolie
fut fondée à Erzurum par l’émir Saltouq, qui reconnut les
Seljouk de Perse comme ses souverains. Les États Artouqid,
qui devaient inclure Diyar Bakr, Mardin et Kharpout, et
l’état de Soukmenli près du Lac de Van n’existaient toujours
pas, et ils n’apparaîtront que dix ans plus tard. Ces
régions étaient gouvernées par les gouverneurs Seljouk à
cette époque. Hormis les territoires de Philarètes et
Gabriel, qui furent considérablement réduits par Souleyman
et le Danishmand Koumoushtakin, la seule partie de
l’Anatolie qui n’était pas aux mains des Turcs était la
région orientale de la Mer Noire. A Trébizonde, qui fut
reprise aux Turcs en 1075, un Duché grec fut fondé. Les
successeurs du Duc restèrent indépendants des Empereurs
Byzantins et formèrent parfois des alliances avec les Turcs.
Abou al-Qassim, que Souleyman laissa comme son adjoint à
Iznik lors de sa campagne en Cilicie et à Antioche, non
seulement détint l’État Seljouk après la mort de Souleyman,
mais s’avança aussi jusqu’au détroit. Malik Shah envoya
d’abord l’émir Boursouq prendre les Seljouk d’Anatolie sous
son contrôle, et fit tuer le frère de Souleyman en 471
(1078). Il envoya ensuite une armée à Iznik sous le
commandement de l’émir Bouzan. Face au danger de l’armée de
Malik Shah, Abou al-Qassim et Alexis formèrent une alliance.
Mais la mort de Malik Shah en 485 (1092), alors que Bouzan
assiégeait Iznik, mit fin à la pression du Grand Seljouk sur
l’Anatolie ; et lorsque les différends sur la succession
commencèrent à la suite de sa mort, le fils de Souleyman,
Kilij Arsalan, fut libéré et se rendu à Iznik en 1092.Les
Turcs l’accueillirent avec une grande joie et
l’intronisèrent.
Le jeune Kilij Arsalan I réorganisa son état, reconstruisit
sa capitale et nomma des gouverneurs et des commandants. Il
chassa également les Byzantins qui tentaient de s’installer
sur les rives de Marmara. En acceptant la coopération de
l’Empereur Byzantin, il disposa de son rival, Chaka Bey, qui
avançait dans la direction des Dardanelles et augmentait son
pouvoir. En conséquence de son traité avec Byzance, il se
sentit libre de se tourner vers l’est pour l’expansion. En
489 (1096), il assiégea Malatya ; mais bien que les
habitants de la ville, en particulier les Chrétiens syriens,
lui offrirent de lui céder la ville afin de se sauver de
Gabriel, qui s’était converti au Christianisme orthodoxe et
s’opposait à eux, Kilij Arsalan fut contraint de revenir
défendre sa capitale contre les croisés.
Le premier groupe des croisés, venu avec Pierre l’Ermite,
fut facilement détruit, mais il fut difficile de résister à
la grande armée organisée qui suivit. Les croisés
assiégèrent Iznik et, bien que Kilij Arsalan se soit
empressé de revenir, il ne put entrer dans la ville. Le 19
juin 1097, les défenseurs d’Iznik se rendirent par accord à
l’armée de l’Empereur. Ces Turcs, les trésors du Sultan et
sa femme, qui était la fille de Chaka, furent tous envoyés à
Constantinople. Kilij Arsalan, prenant comme alliés le
Danishmand Koumoushtakin et l’émir de Cappadoce, Hassan
Bey, rencontra les Croisés à Eskishehir, où, le 17 Rajab 490
(1 juillet 1097), une grande bataille eut lieu. Les deux
armées combattirent vaillamment et il y eut beaucoup
d’effusion de sang. Un chroniqueur parmi les croisés
décrivit comment les Seljouk combattirent en ces termes : «
Si les Turcs avaient été Chrétiens, personne n’aurait pu
être leurs égaux dans la bataille et la bravoure. » Mais les
croisés avaient une supériorité écrasante sur les Turcs.
Pour cette raison, Kilij Arsalan recula, afin de ne pas
réduire son armée par de nouvelles pertes. Bien qu’il ait de
nouveau combattu les Croisés avec Koumoushtakin et Hassan
Bey à ses côtés à Ereghli près de Konya, il subit de très
lourdes pertes et dû battre en retraite. Une montagne fut
nommée d’après l’émir Hassan (Hasan-dagh) car un
grand nombre de ses soldats y furent tués, et plus tard des
sanctuaires virent le jour dans cette région en sa mémoire.
Bien que de grandes pertes aient été subies par les Turcs
d’Anatolie, à la fois en terres et en effectifs, à la suite
de la première croisade, ils se rétablirent rapidement.
Durant le mois de Ramadan 493 de l’Hégire (5 juillet 1100),
Koumoushtakin Ahmed Ghazi rencontra les croisés
venant de Syrie et les battit à Malatya, faisant prisonnier
Bohémond et d’autres grands princes. En 1100 également, lui
et Kilij Arsalan anéantirent complètement deux grandes
armées de croisés, l’une près d’Amasya et l’autre à Ereghli,
alors qu’ils se battaient pour libérer les croisés
emprisonnés à Niksar. Ces victoires améliorèrent le moral de
Kilij Arsalan et des Turcs d’Anatolie, qui avaient
auparavant souffert aux mains des croisés. Après la chute
d’Iznik, Kilij Arsalan fit de Konya sa capitale. En
concluant un accord avec l’Empereur contre les croisés, il
put se tourner pour conquérir l’est, comme l’avait fait son
père. Il vainquit d’abord les Danishmand et les prit sous sa
suzeraineté. En 496/1103, il captura Malatya de
Koumoushtakin, qui l’avait conquise en 494 (1101), et y
établit sa propre administration. Il tourna ensuite son
attention vers les principautés de l’Anatolie orientale, et
leur fit reconnaître en lui leur seigneur. En rivalité
traditionnelle avec les Grands Seljouk, il annexa Mossoul.
Mais il fut impliqué dans une bataille violente sur le
fleuve Khabur contre une forte armée envoyée par le Grand
Sultan Seljouk Muhammad et, comme son père, il perdit
la vie à cause de cette rivalité, le 9 Shawwal 500 (3
juillet 1107). Bien que l’État Seljouk de Roum déclina
sérieusement à la suite de la mort de son père et des
attaques des croisés, il reprit et devint plus fort que
jamais sous sa direction mais il subit une crise encore plus
grande avec sa propre mort.
La période de crise et la retraite des Turcs en Anatolie centrale
Comme son père, Kilij Arsalan laissa le trône de Konya sans
propriétaire à sa mort. Son fils aîné, Shahinshah, alors
gouverneur de Mossoul, fut emmené à Ishfahân en tant que
prisonnier, et ne put retourner à Konya, pour devenir
Sultan, jusqu’en 504 (1110). Profitant de cette période de
crise, les Byzantins prirent l’initiative d’attaquer toutes
les zones côtières d’Anatolie. Partout, les Turcs se
préparèrent à se déplacer vers le plateau central
d’Anatolie. Mais leur retraite leur coûta de grandes pertes.
Une grande foule de Turcs qui campaient près d’Ulubad
(Lopadion), en route vers le centre de l’Anatolie, furent
attaqués par les Byzantins. La plupart d’entre eux, y
compris les femmes et les enfants, furent massacrés. Malgré
quelques contre-attaques réussies de l’émir Hassan de
Cappadoce et de Shahinshah qui régnaient à Konya, la
retraite générale ne put être arrêtée. Alexis et son
successeur, Jean II, soit expulsèrent les Turcs de l’ouest
de l’Anatolie et des régions côtières du nord et du sud,
soit les détruisirent.
Le souverain Danishmand l’émir Ghazi, 449-529 (1105-34), le
fils de Koumoushtakin, aida son gendre Mas’oud à prendre le
trône à Konya de son frère Shahinshah en 510 (1116), et
ainsi l’État Seljouk fut réduit à un petit royaume, limité
aux environs de Konya, sous la protection Danishmand. Dans
ces circonstances, l’Empereur Jean II (1118-43) continua ses
attaques, vainquit les Turcs et occupa les villes de Denizli
(Laodice) et Uluborlu (Sozopol). Mais en 514 (1120), l’émir
Ghazi, profitant des opérations byzantines dans les Balkans
et avec le soutien des Artouqid, vainquit le Duc de
Trébizonde et son allié, le dirigeant Menqouchek, à Shiran.
Bien que le Sultanat fût entre les mains des Seljouk, les
vrais dirigeants de l’Anatolie étaient alors les Danishmand.
Lorsque l’autre frère du Sultan Mas’oud ‘Arab, qui s’était
installé à Ankara et Kastamonu, marcha sur Konya pour
s’emparer du trône Seljouk en 520 (1126), Mas’oud forma une
alliance avec l’Empereur et vainquit son frère, le forçant à
se réfugier en Cilicie. Cela permit aux Byzantins d’occuper
Kastamonu. Mais l’expédition de l’Empereur en Cilicie, et
plus tard les tentatives de son frère pour s’emparer du
trône, aidèrent l’émir Ghazi à chasser les Byzantins et à
occuper la rive de la Mer Noire. Le Sultan Mas’oud, d’autre
part, commença à avancer dans l’ouest de l’Anatolie. L’émir
Ghazi entra alors en Cilicie et vainquit les croisés en
progression. En peu de temps, il devint le dirigeant de
toutes les provinces anatoliennes entre la Sakarya et
l’Euphrate.
Le calife[1]
et le Sultan Sanjar lui confèrent le titre de Malik (roi) et
lui envoyèrent un tambour et un étendard comme emblèmes de
souveraineté, étant le dirigeant le plus puissant
d’Anatolie.
À la mort de Malik Ghazi en 529 de l’Hégire (1134), le
Sultan Mas’oud, jusque-là sous sa protection, devint l’allié
et l’égal du fils de son protecteur, Malik Muhammad.
Tandis que l’Empereur Jean punissait les Arméniens en
Cilicie et se disputait avec les croisés, les Seljouk et les
Danishmand n’eurent aucune difficulté à étendre leurs
frontières contre les Byzantins. Cela fit marcher l’Empereur
en 534 (1140) vers la capitale danishmand, Niksar, avec une
grande armée, afin de détruire les Turcs d’Anatolie. Il
était également déterminé à se débarrasser de Théodore
Gabras, le Duc de Trébizonde. Il atteignit Niksar après
avoir subi de lourdes pertes dans le nord de l’Anatolie, et
assiégea la ville.
Pendant le siège, de longues et violentes batailles eurent
lieu entre les Turcs et les Grecs. La prolongation du siège
provoqua des troubles dans l’armée byzantine et l’un des
princes impériaux, Jean, se réfugia dans le camp du Sultan
Mas’oud. La désertion du prince, devenu Musulman et installé
à Konya après avoir épousé la fille du Sultan, contraignit
l’Empereur à revenir tranquillement à Constantinople par la
Mer Noire en 1141. L’échec de cette grande campagne, qui
avait commencé si ambitieusement, ouvrit des possibilités de
nouvelles conquêtes turques et le Sultan Mas’oud s’avança
jusqu’à la région d’Antalya.
Lorsque les Danishmand commencèrent à se quereller entre eux
pour la royauté sur Malik Muhammad, décédé en 536
(1142), Sultan Mas’oud vainquit le Malik Danishmand de
Sivas, Yaghi Bassane, assiégea Malatya et annexa la région
Jayhan de son territoire. Avec ce développement soudain, la
domination de l’Anatolie passa à nouveau des Danishmand aux
Seljouk. Tandis que le Sultan Seljouk étendait ses
frontières vers l’est, profitant des querelles entre les
Atabegs de Mossoul et les Artouqid, les Turcomans avançaient
dans l’ouest de l’Anatolie, en suivant les vallées des
Menderes et du Gediz. L’Empereur Manuel I Comnène partit
avec une grande armée pour chasser les Turcs d’Anatolie.
Après avoir débarrassé l’Anatolie occidentale des Turcs, il
marcha sur Konya ou il vainquit les forces Seljouk à
Akshehir, brûla la ville et avança en direction de Konya.
Lorsque le Sultan Mas’oud fut informé du danger imminent, il
revint précipitamment de l’est, prépara son armée à Aksaray
et rencontra l’Empereur avant Konya. Les Byzantins avaient
complètement dévasté la région de Konya, tué un grand nombre
de personnes et même ouvert des tombes. Mais ils furent pris
par surprise lorsque les Seljouk les attaquèrent. Ils se
retirèrent après avoir été sévèrement battus, et ainsi la
campagne 1147 se solda également par un échec. Malgré cette
bataille, cependant, le début d’une nouvelle croisade
contraignit aussitôt les deux dirigeants à se mettre
d’accord face au danger commun.
Lorsque l’Atabeg ‘Imad ad-Din az-Zanki (puisse Allah Exalté
lui faire Miséricorde) reconquit Urfa (Edessa) en 539
(1144), la deuxième croisade fut organisée en Europe sous la
direction de l’Empereur Conrad III et du Roi Louis VII de
France. Ce fut la première fois dans l’histoire des
croisades que les dirigeants eux-mêmes participeraient à la
campagne. L’armée allemande qui était dirigée par des guides
« perfides » de l’Empereur byzantin Manuel par de mauvaises
routes, subit des attaques surprises des Turcs et fut
massivement vaincue près d’Eskishehiron le 28 Joumadah
al-Oula 542 (25 octobre 1147) ; certains de ceux qui
tentèrent de rentrer furent détruits par les attaques
grecques. À la suite de ce grand désastre, le Roi de France
se rendit compte de l’impossibilité de traverser le
territoire Seljouk et essaya de suivre la route via Éphèse,
Denizli et Antalya. Mais il ne put atteindre Antalya
qu’après avoir subi de lourdes pertes lors des attaques
turques, et là seuls ceux qui avaient de l’argent purent
naviguer vers la Syrie. Ceux qui furent laissés pour compte
souffrirent des attaques turques, du pillage grec, de la
faim et de la maladie. Leur état était si mauvais que les
Turcs eurent pitié d’eux, leur donnèrent de la nourriture et
de l’argent et soignèrent leurs malades.
Un chroniqueur chrétien parle ainsi de l’épisode :
« Fuyant leurs coreligionnaires qui avaient été si cruels
envers eux, ils allèrent en sécurité parmi les infidèles[2]
(lire Musulmans) qui avaient pitié d’eux, et, comme nous
l’avons entendu, plus de trois mille se joignirent aux Turcs
lorsqu’ils se retirèrent.
Oh, bonté plus cruelle que toute trahison ! Ils leur
donnèrent du pain mais leur volèrent leur foi, bien qu’il
soit certain que satisfaits des services qu’ils rendaient,
ils n’obligeaient personne parmi eux à renoncer à sa
religion. »
[1]
Nous n’attribuons pas de majuscule au mot calife
puisque les seuls Califes dignes de Majuscules
furent les 5 premiers Califes et l’Islam ainsi que
le Calife Amawi ‘Abd al-‘Aziz Ibn Omar nommés à
l’unanimité par les savants de l’Oummah comme les
Califes Bien-Guidés. Nous avons déjà mentionnés cela
dans nos précédents ouvrages.
[2]
Si les Musulmans qui adorent un Seul Dieu sont
traités d’infidèles que dire alors de ceux qui
adorent la Trinité 1+1+1=1 ! Ils sont trois fois des
impies ! |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)