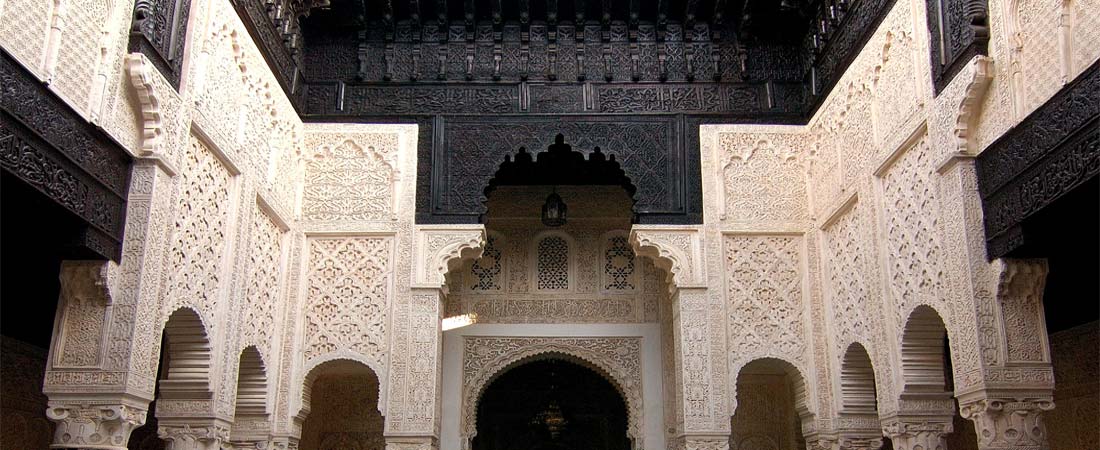|
|
Sharif Muhammad
al-Jouti
Dans le vide politique laissé par la chute de la dynastie des Marine
Banou, le pouvoir fut pris par Sharif Muhammad al-Jouti qui
se réclama de la descendance de Moulay Idriss, le fondateur de la
dynastie des Banou Idriss.
Les Banou Wattis
A l’aube du dixième siècle de l’Hégire (seizième siècle), le Maroc
était à l’agonie et dans un état de dégénération politique et
sociale.
Muhammad ash-Sheikh, l’émir des Banou Wattis était toujours
sur le trône mais la désintégration des Banou Wattis était déjà bien
avancée. Muhammad ash-Sheikh décéda en l’an 911 de l’Hégire
(1505) qui fut succédé par deux souverains des Banou Wattis, Ahmad
qui régna de l’an 911 à 932 de l’Hégire (1505 à 1526) et Abou (Bou)
Hassan qui régna de l’année 932 à 955 de l’Hégire (1526 à
1548) et après lui, le règne des Banou Wattis prit fin.
Les ports du Maroc étaient toujours occupés par les Portugais qui
contrôlaient le commerce maritime au dépend du Maroc. Les Banou
Wattis s’allièrent avec les Portugais et deux familles des Sharif
qui prétendaient être les descendants du Prophète de l’Islam (Saluts
et Bénédictions d’Allah sur lui), par sa fille Fatima (qu’Allah soit
satisfait d’elle) appelèrent à chasser les Banou Wattis et les
Portugais. Ces deux familles soufis étaient les Sharif du Jabal
‘Alam au nord et les Banou Sa’d au sud.
Les Sharif du Jabal ‘Alam
Les Sharifs de Jabal ‘Alam se réclamèrent descendre de la dynastie
des Banou Idriss qui vinrent s’établir au troisième siècle de
l’Hégire (neuvième siècle) comme nous l’avons déjà mentionné dans le
premier volume. Ils fondèrent la ville de Chefchaouen qui devint la
base de leurs activités. Leur influence ne put s’étendre au-delà du
nord-ouest du Maroc, coincés entre les Banou Wattis à Fès et les
Portugais sur la côte. Ainsi, ils n’étaient pas en position pour
mener une action politique et agirent comme un état tampon.
Moulay Ibrahim, leur émir entre les années 926 à 936 de l’Hégire
(1520-1530), poursuivit une politique de coexistence et bien qu’il
ait fait des raids occasionnels sur le territoire portugais, il ne
put lancer de Jihad contre l’envahisseur et son laquais.
D’autre part, il cultiva des relations amicales avec ses voisins,
eut des relations courtoises avec les Portugais, échangea des
cadeaux avec eux puis se maria à une fille de l’émir des Banou
Wattis. Par sa politique d’inaction le Sharif du Jabal ‘Alam disparu
de la scène politique quand une autre dynastie de Sharif au sud se
montra à la hauteur du pouvoir.
Abou ‘AbdAllah Muhammad
al-Qayim fondateur de la dynastie des Banou Sa’d
La dynastie des Sharif du sud s’éleva dans la région du Dar’a sur la
pente Saharienne de l’Atlas dans la tribu des Bani Sa’d et fut
connue sous le nom des Sharif Banou Sa’d. Le fondateur de dynastie
fut Abou ‘AbdAllah Muhammad al-Qayim qui fut nommé chef des
Banou Sa’d à Souss en l’an 916 de l’Hégire (1510) et c’est
progressivement qu’ils bâtirent leur pouvoir politique. Ils
construisirent une forteresse à Taroudant pour protéger leur arrière
puis prirent Tafilalet et la lisière du sud du Haut Atlas. Abou
‘AbdAllah Muhammad al-Qayim décéda en l’an 923 de l’Hégire
(1517).
Ahmad
al-A’raj
Abou ‘AbdAllah Muhammad al-Qayim fut succédé par son fils Ahmad
al-A’raj qui entreprit des campagnes contre les Banou Wattis et en
l’an 930 de l’Hégire (1524), les Sharif Banou Sa’d leur arrachèrent
Marrakech qui devint leur capitale.
En l’an 932 de l’Hégire (1526), les Banou Wattis furent vaincus à
Wadi al-’Abid et reconnurent les Sharif Banou Sa’d souverains du
Maroc du Sud.
Muhammad
ash-Sheikh
En l’an 947 de l’Hégire (1540), Ahmad al-A’raj fut renversé
par son frère Muhammad ash-Sheikh qui attaqua les Portugais
et les chassa du Maroc.
Le port d’Agadir fut capturé en l’an 948 de l’Hégire (1541), les
ports de Safi et d’Azemmour en l’an 949 de l’Hégire (1542) et en
l’an 956 de l’Hégire (1549), les Portugais furent chassés de Qasr
as-Saghir et d’Arzila.
Le succès de Muhammad ash-Sheikh sur les Portugais améliora
sa réputation et son prestige et par la suite, il se retourna contre
les Banou Wattis et chassa leur souverain Abou Hassan et
captura Fès en l’an 956 de l’Hégire (1549). Abou Hassan
chercha de l’aide auprès des Ottomans et reprit Fès en l’an 960 de
l’Hégire (1553).
Vers la fin de cette même année, il y eut une autre bataille à Wadi
al-’Abid contre les Banou Wattis au cours de laquelle Muhammad
ash-Sheikh remporta une victoire décisive. L’émir des Banou Wattis
fut pris captif et tué tandis que Muhammad ash Sheikh devint
le maitre incontesté de tout le Maroc.
Comme la plupart des ordres soufis à Fès avaient soutenu les Banou
Wattis et les Ottomans, Muhammad ash-Sheikh prit des mesures
fermes contre les ordres soufis et la plupart des Zawiyas
furent fermées, leurs propriétés confisquées les disciples dispersés
et al-Wanshirissi, leur principal chef fut assassiné.
Après avoir consolidé sa position au Maroc, Muhammad
ash-Sheikh tourna son attention vers les Ottomans, qui avait aidé le
Banou Wattis et qui étaient hostiles aux Sharif Banou Sa’d. Muhammad
ash-Sheikh employa certains Turcs dans son armée pour rencontrer les
Ottomans au même niveau et attaqua Tlemcen et bien qu’il captura la
ville, il ne put prendre la citadelle de Tlemcen et se retira à Fès.
Muhammad ash-Sheikh préleva quelques taxes qui provoquèrent
un mécontentement chez certaines tribus du Haut Atlas qui se
révoltèrent en protestation et Muhammad ash-Sheikh marcha
contre eux à la tête d’une armée pour réprimer la révolte et
collecter les taxes. Mais en l’an 964 de l’Hégire (1557), il fut
assassiné par certains de ses soldats turcs qui étaient en fait des
agents ottomans d’Algérie.
Le règne de Muhammad ash-Sheikh dura dix-sept ans et il fut
le réel fondateur de la dynastie des Banou Sa’d. C’est sous son
règne que les Portugais furent chassés des côtes du Maroc et que les
Banou Sa’d en devinrent les maîtres.
‘AbdAllah
al-Ghalib
Muhammad ash-Sheikh fut succédé par son fils ‘AbdAllah
al-Ghalib qui s’allia avec les Espagnols contre les Ottomans.
En l’an 967 de l’Hégire (1560), il envoya une armée en Algérie pour
capturer Tlemcen mais l’expédition échoua et les forces marocaines
durent se retirer de l’Algérie.
Les armées marocaines eurent néanmoins un peu de succès au sud où
ils capturèrent Tombouctou. ‘AbdAllah al-Ghalib entra en conflit
avec certains ordres soufis et massacra les membres de la fraternité
de youssoufiyah. Puis, il consacra une attention particulière à
l’embellissement et la décoration de Marrakech. Il construisit une
magnifique mosquée et des Madariss (écoles).
Al-Ghalib décéda en l’an 982 de l’Hégire (1574) après un règne de
dix-sept ans.
Muhammad
al-Moutawakkil
Muhammad al-Moutawakkil succéda à son père mais les Ottomans
semèrent la division dans les rangs des Banou Sa’d et incitèrent
‘Abdel Malik, un oncle d’al-Moutawakkil, à se rebeller contre
l’autorité de son neveu. Avec l’aide des Ottomans, ‘Abdel Malik
renversa al-Moutawakkil en l’an 984 de l’Hégire (1576) après un
règne d’à peine deux ans.
‘Abdel Malik
Sous le règne de ‘Abdel Malik, le Maroc devint un annexe des
Ottomans et les Khoutbah (sermons) furent lues dans les
mosquées au nom des califes ottomans de Turquie. Il s’habilla comme
les Ottomans, promut la culture ottomane au Maroc et son armée fut
contrôlée par des officiers de l’armée ottomane.
Al-Moutawakkil, renversé, s’enfuit au Portugal à qui il demanda de
l’aide pour être réintégrer son poste de souverain et s’engagea à
leur rendre les territoires côtiers dont les portugais avait été
chassé sous le règne de Muhammad ash-Sheikh. Sébastian, le
roi du Portugal, planifia alors une grande invasion du Maroc après
avoir obtenu l’aide d’autres pays européens et les bénédictions de
Pape qui déclara son invasion une croisade.
Sébastian débarqua au Maroc en l’an 986 de l’Hégire (1578) à la tête
d’une immense force de croisés, accompagné par l’apostat
al-Moutawakkil et une sanglante bataille eut lieu à Qasr al-Kabir
cette même année au cours de laquelle les croisés subirent une
lourde défaite. La plus grande partie des croisés furent détruits
tandis que les survivants se retirèrent en hâte en Espagne.
Dans la bataille de Qasr al-Kabir, les trois rois qui y
participèrent furent tués et cette bataille que nous allons
particulièrement développer, fut appelée « la bataille des Trois
Rois ».
Quant au gouvernement d’Abdel Malik, il dura de l’année 984 à 986 de
l’Hégire (1576 à 1578).
Introduction à la bataille des trois rois ou de Wadi Makhzan
Dans les annales de l’humanité, tant chez les Musulmans que chez les
mécréants, un certain nombre de batailles décisives décidèrent pour
des décades voir même des siècles, du destin de civilisations.
Parmi ces batailles sont les
célèbres :
- Bataille de Hattin ou al-Malik an-Nassir Salah
ad-Din Ayyoubi écrasa les croisé au Levant et,
- La bataille de ‘Ayn Jalout ou l’armée égyptienne, d’Abou al-Foutouh
al-Malik az-Zahir Rouqn ad-Din Baybars al-Boundouqdari l’un des
commandants des forces qui écrasèrent le roi croisé Louis IX, arrêta
l’avance de la marée mongole.
Un autre de ces événements très peu connut qui fit trembler le monde
est celui de la bataille connue sous le nom de « Qasr al-Kabir »,
une importante bataille entre les forces du Portugal et du Maroc.
Cette bataille a aussi pour nom :
- La bataille d’Alcacer,
- La bataille des trois rois,
- La bataille de Ksar El Kébir (qasr al-kabir) et enfin,
- La bataille de Wadi Makhzan.
Les ambitions du souverain fanatique du Portugal
En l’an 978 de l’Hégire (1570), le Portugal était gouverné par
Sébastian qui, en l’an dans 976 de l’Hégire (1568), à l’âge de 14
ans, accéda au trône. Au moment de son ascension, il était un jeune
homme malade, entêté, orgueilleux et un fanatique religieux,
indifférent à tout excepté ses impulsions entêtées. Il avait deux
passions dans la vie : la guerre et la religion.
Les années passèrent et son obsession d’organiser une grande
Croisade contre les « infidèles » (les Musulmans) l’emporta. Il
mourait d’envie de lutter contre les « ennemis de Dieu » et tuer des
Maures. Son ambition primaire était de conquérir le Maroc, mais
d’autres projets impérialistes dans les pays des « païens »
hantèrent aussi son imagination. Ce jeune zélé était hanté par des
rêves de conquête et d’expansion de la « sainte foi chrétienne » et
ses espoirs mélangés de ferveur religieuse, avaient le soutien de la
plupart de ses compatriotes.
Depuis la défaite des Maures au Portugal durant le septième siècle
de l’Hégire (treizième siècle), il y avait eu une intensification de
l’esprit de croisade, stimulée par la capture de Grenade par les
croisés, environ trois quarts d’un siècle plus tôt qui avait poussé
ses ancêtres à envahir l’Afrique du Nord et préparer son grand
dessein.
Au début du dixième siècle de l’Hégire (fin du quinzième siècle), le
Portugal avait déjà pris le contrôle de la plupart des côtes
marocaines et était disposé à prendre le pays entier.
Après avoir occupé Azemmour en l’an dans 919 de l’Hégire (1513),
comme un prélude à leur conquête des importantes villes de Marrakech
et de Fès, la fibre patriote ibérique était à son plus haut degré,
reflétée dans les vers du dramaturge du seizième et poète Gil
Vincente qui écrivit :
« Le Roi de Fès défaille,
Marrakech criaille.
Car l’Afrique était baptisée,
Les Musulmans vous l’ont volé...
Mais maintenant Sa Majesté est décidée
De glorifier la foi,
De faire des mosquées des cathédrales,
Par la grâce divine, à Fès.
Pour la guerre, oui, la guerre perpétuelle
Est maintenant sa grande intention ».
La croisade portugaise contre le Maroc
Au Maroc, les invasions portugaises provoquèrent une effervescence
de sentiment qui devait susciter finalement, après des années de
divisions, la réunification du pays sous la dynastie des Bou Sa’d.
Cependant, considérant les Maures comme moins que rien, Sébastian
ferma les yeux sur ces évènements, aveuglé par son obsession tandis
qu’il dressait ses plans pour la
« sainte croisade » et la « guerre sainte (harb
mouqaddas) » contre les Musulmans.
La chance inouïe de mettre en action sa stratégie pour la conquête
de l’Afrique du Nord lui fut offerte quand le souverain marocain Muhammad
al-Moutawakkil des Banou Sa’d, qui était un souverain traître et
apostat, fut renversé par son oncle, ‘Abdel Malik al-Mou’tassim, un
homme cultivé et érudit. Muhammad s’enfuit au Portugal pour
demander de l’aide aux mécréants et Sébastian, tenant son rêve à
portée de main, accepta d’aider le Sultan déposé, non pas pour le
bénéfice du traitre Maure dont il pourrait facilement se débarrasser
mais pour sa propre gloire et la conquête du Maroc.
Sébastien ordonna aussitôt de lever une armée et de l’argent pour
l’expédition avec l’accord de la majorité de ses conseillers qui
étaient d’accord avec son projet bien que les historiens occidentaux
rapportèrent le contraire pour couvrir l’humiliant résultat de la
bataille se contredisant eux même après avoir affirmé que tous
étaient patriotiquement excités à l’idée du projet !
Avec l’intense désir d’imiter ses aïeuls et porté par ses partisans
juvéniles, il rassembla tous les combattants du Portugal et reçut
l’aide des fanatiques religieux et d’autres mercenaires
d’Angleterre, de Flandres, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Irlande,
d’Italie et d’Espagne qui répondirent à l’appel du pape Grégoire
XIII pour la nouvelle croisade. Ce même pape qui autorisa les
inquisiteurs à procéder librement, qui condamna les pratiques des
Juifs, interdit le Talmud et interdit aux médecins juifs et
« infidèles » (Musulmans) de soigner les chrétiens dans toutes les
terres chrétiennes.
Accompagné par cette armée de croisés, toute la chevalerie et les
richesses accumulées de sa nation, Sébastian quitta Lisbonne au mois
de Rabi’ Awwal de l’année 986 de l’Hégire (juin 1578) avec 800
navires, 1.200 selon les historiens marocains de l’époque,
transportant, selon les historiens musulmans de l’époque entre
80.000 et 125.000[1]
soldats et selon les historiens occidentaux récents, le plus bas
chiffre que j’ai trouvé après une journée de recherche est de 15.000
soldats parce qu’ils n’ont pas pu dire moins à cause des 600 navires
de transport qu’ils reconnaissent. Néanmoins je reste persuadé
qu’avec des recherches plus poussée, certains ont rapporté des
chiffres nettement inférieurs.
Des chiffres contradictoires
Quant aux nombres rapportées par les occidentaux, ils sont non
seulement contradictoires, chacun donnant sa propre estimation de la
bataille à laquelle nul d’entre eux ne participa, mais complètement
irréalistes et frisant le ridicule, n’ayant d’autre but que de
couvrir la défaite. Après une recherche superficielle sur Internet,
voici donc un échantillon des nombres rapportés avec les sources
afin que vous puissiez vérifier par vous-même et ils sont très peu
surprenants :
- 15.000 : http://www.ustratos.com/search?q=makhazine.
- 16.000 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Ier_du_Portugal.
- 17.000 :
http://www.bibliomonde.com/livre/fables-memoire-glorieuse-bataille-des-trois-rois-828.html.
- 18.000 :
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Alc%C3%A1cer_Quibir.
- 20.000 :
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/593809/Battle-of-the-Three-Kings.
- 23.000 : http://i-cias.com/e.o/battle_three_kings.htm.
- 24.000 :
http://www.scribd.com/doc/36921163/40/THE-BATTLE-OF-THE-THREE-KINGS.
- 25.000 : http://www.syriatoday.ca/salloum-kasr.htm.
- 44.000 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_l%27Oued_Makhzen.
- 70.000 : http://www.syriatoday.ca/salloum-kasr.htm.
- 120.000 : http://www.ustratos.com/search?q=makhazine.
Pour vous donner un autre exemple grotesque et que je vous invite à
vérifier, j’ai trouvé ce qui suit sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/1578 :
« 12 juillet : Les troupes de Sébastien I de Portugal débarquent à
Assilah avec 17.000 hommes et 600 navires pour protéger les présides
portugais contre la poussée du royaume du Maroc.
4 août : Bataille des Trois Rois, ou bataille de Oued el-Makhazin,
appelée aussi bataille de Ksar el-Kébir. Mort de Sébastien Ier de
Portugal, battu par les troupes d’Abd el-Malik. 8000 portugais sont
tués, 10 à 20.000 sont fait prisonniers, une centaine peut gagner
Tanger et transporter la nouvelle à Lisbonne. Trois souverains
meurent au cours du combat. Don Sébastien et al-Mottaouakkil sont
noyés, et Abd el-Malik meurt de maladie. Son frère Ahmed est
proclamé sultan sur le champ de bataille. Il prend le nom
d’al-Mansur (le victorieux) et fonde la dynastie saadienne qui
atteint son apogée sous son règne. Il fait régner l’ordre avec une
armée de mercenaires (renégats, Turcs…) (fin de règne en 1603) ».
Fin de citation.
En plus de mensonge (« pour protéger les présides portugais contre
la poussée du royaume du Maroc »), je vous invite à compter les
chiffres et même si vous n’avez pas le BEPC, le niveau cours
élémentaire deuxième année suffira largement : 17.000 débarquent,
8.000 sont tués, entre 10 et 20.000 sont pris prisonniers et une
centaine réussit à s’enfuir.
Question : Combien étaient-ils au départ ?
C’est que la mauvaise foi à des cimes et le ridicule des adeptes !
Le débarquement des croisés
Sébastian rassembla dans la plus grande baie portugaise, le port de
Lagos en eaux profondes, toute la flotte portugaise. Et, après avoir
renforcé son armement par de nouvelles pièces d’artillerie, fait
provision d’armes, de munitions et de vivres et embarqué tout son
matériel, Sébastian prit la mer avec son armée le 20 du mois de
Rabi’ Thani de l’année 986 de l’Hégire (26 juin 1578). L’expédition
fit halte, une quinzaine de jours, à Cadis ou de larges renforts
venus d’Europe se joignirent à sa croisade avant de reprendre le
large le 8 juillet et accoster en rade de Tanger.
Sébastian en état de ravissement, réconforté par la vue de
l’innombrable flotte qui l’accompagnait, navigua vers le sud et
l’approche de la côte africaine réveilla son désir pour la gloire de
la guerre sainte contre l’infidèle. L’armée débarqua à ‘Assilah et
campa sur la plage près de la ville ou pendant 18 jours, les navires
déchargèrent leurs flancs dont en plus des combattants et de leur
logistiques, des prêtres, des montures, des courtisans et, selon
certains historiens 9.000 prostituées allemandes et 2.000 chariots,
tirés par les chevaux.
Lorsque les bagages furent enfin chargés dans les wagons, le lundi 4
août 1578, Sébastien revêtit une belle armure brillante qu’il
couvrit d’une pièce en cuir pour atténuer les éclats des rayons du
soleil et appela ses commandants pour déployer son armée selon le
plan de bataille qu’ils avaient élaborés. L’avant-garde fut confiée
à trois corps de troupe, l’aile gauche aux Espagnols et aux
Italiens, l’aile droite aux Allemands et le centre à des mercenaires
et des partisans d’al-Moutawakkil. Des deux côtés du convoi
transportant ses 36 pièces d’artillerie, 200 selon les historiens
musulmans[2],
il plaça ses corps d’arquebusiers portugais encadrés par la
cavalerie.
L’armée prête pour le départ, Sébastien s’adressa alors à ses
troupes et : « les exhorta à s’exposer courageusement pour
l’exaltation de la « sainte foi » et la religion chrétienne, promit
la rémission des péchés, le paradis, des biens, des faveurs et les
assura de la victoire et de la grâce divine en laquelle il avait
toute son espérance et qu’il espérait de son dieu avec un cœur très
chrétien et zélateur... » Et tandis qu’il parlait, les évêques, le
commissaire de « sa sainteté apostolique », et plusieurs
représentants tant séculiers que religieux de divers ordres,
crucifix en main, circulaient à travers les régiments et les
escadrons, les exhortaient et les encourageaient à mourir bravement
pour la sainte foi catholique tout en leur prodiguant force
bénédictions et invocations pour le salut de leur âme.
Lorsque le sermon fut enfin terminé, Sébastien retourna au centre de
l’armée qui se mit en marche. Son plan étaient de prendre
Qasr al-Kabir puis de marcher ensuite vers Fès.
Le 20 du mois de Rabi’ Awwal (24 juillet), un renégat français se
présenta devant les commandants portugais et les informa que ‘Abdel
Malik était à salé avec 34 canons, 17.000 cavaliers et 7.000
arquebusiers. « Les conseillers de Sébastian lui conseillèrent de
retourner en arrière, mais il refusa d’écouter leur conseil,
convaincu de sa propre infaillibilité, de sa juste Croisade, que son
dieu était avec lui et la certitude de la victoire[3] ».
[1]
Muhammad as-Saghir Ibn al-Hajj Muhammad
Ibn ‘AbdAllah al-Ifrani al-Marakkashi dans son livre « nouzhat
al-hadi bi-akhbar moulouk al-qarn al-hadi » a
rapporté : « Les Chrétiens mirent en ligne dans cette
bataille des forces considérables et le nombre de leurs
combattants s’éleva, dit-on, au chiffre de 125.000. Ils
avaient conçu le projet de ruiner le Maroc, de presser les
Musulmans de toute part, et de broyer les adeptes de la foi
sous la meule de l’avilissement; aussi le cœur rempli de
terreur, la poitrine envahie par l’angoisse, les populations
effrayées avaient-elles cru que leur dernière heure était
venue…mais il ajoute que 25.000 hommes restèrent à bord des
navires et que les 100.000, qui entrèrent en ligne au moment
du combat, furent tous tués ou faits prisonniers. Quant à Muhammad
al-Moutawakkil Ibn ‘AbdAllah, il n’avait avec lui qu’environ
trois-cents de ses compagnons ».
|
|