
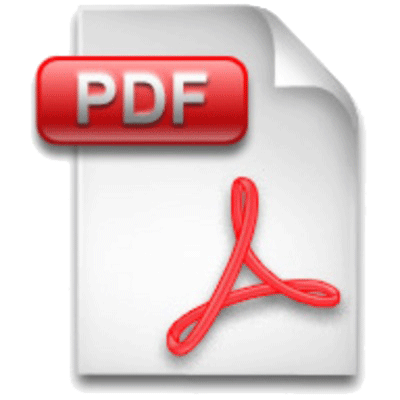 |
En
l’an 329 de l’Hégire (940), soit seulement deux ans après sa
défaite, ‘AbderRahmane an-Nassir remarcha vers le royaume de
Léon à la tête de sa nouvelle armée reconstituée.
Il
prit toutes les forteresses qu’il trouva sur sa route et les
renforça pour en faire des bases musulmanes. Puis, il fit construire
au nord la ville de Salem (salim) et en fit une garnison
permanente des forces musulmanes. Et c’est de cette ville fortifiée
qu’il allait dorénavant organiser ses raids alors qu’auparavant,
c’est de Cordoue qu’il envoyait ces troupes.
Cordoue était trop loin pour permettre des envois rapides tant de
troupes que de logistique et c’est de sa défaite qu’il en tira
leçon. Dorénavant la ville de Salem, à la frontière du Royaume de
Léon, allait être le rempart de ses futures actions.
Lorsqu’il réussit à unifier l’Andalousie et qu’il mit fin aux
incursions des Chrétiens, il se consacra au développement et à la
modernisation du pays.
De
Byzance, arriva une mission diplomatique recherchant l’ouverture
entre les deux pays et un échange d’ambassadeur. An-Nassir fit
visiter aux ambassadeurs la ville de Cordoue et ils s’émerveillèrent
de l’avancée technique des Musulmans. Il envoya de même, des
ambassadeurs à Constantinople (qonstantiniya) avec des
présents.
Il
réussit aussi à conclure des agréments de paix avec les royaumes du
nord qui lui causait tant de problèmes afin de permettre aux
Musulmans de s’organiser.
En
l’an 339 de l’Hégire (950), Ramirez II, roi de Léon, décéda et ses
deux fils Antonio et Sancho se partagèrent le royaume mais Antonio
refusa le partage et an-Nassir accorda son aide à Sancho qui devint
nouveau roi de Léon. Ainsi an-Nassir diminua le danger qui pesait
sur ses épaules et il put se vouer à son plan de modernisation.
Bilan du règne de ‘AbderRahmane an-Nassir
L’Andalousie retrouva sa grandeur bien que partout les Musulmans
vivaient des temps difficiles de divisions et de rebellions. A cette
époque, il y avait trois califes pour les Musulmans :
- Le
calife abbasside à l’est en Iraq à Bagdad,
- Le
calife ‘oubaydi au Maghreb et,
- Le
calife omeyyade en Andalousie.
Pendant le règne de ‘AbderRahmane an-Nassir, l’Andalousie
atteignit un niveau fabuleux de grandeur culturelle et de modernité
comme nulle part ailleurs.
Cordoue, la capitale d’Andalousie, était une grande ville de plus de
500.000 habitants, chiffre incroyablement élevé pour l’époque, et la
seule ville au monde contenant un nombre aussi élevé d’habitants.
Les
maisons spacieuses et les palais non seulement rivalisaient en
beauté mais étaient aussi en très grand nombre divisés en vingt-huit
secteurs comprenant plus de 3.000 mosquées. Essayez de comparer ces
nombres de mosquées par rapport à nos jours avec n’importe quelle
métropole : nulle ville n’a jamais et ne pourra jamais rivaliser
avec ses chiffres. Ce qui nous prouve l’importante ferveur
religieuse de l’époque.
En
fait seul Bagdad à l’époque pouvait rivaliser avec Cordoue et
Cordoue fut surnommée « le joyau du monde ».
La mode et la cuisine raffinée
Les
gens aussi adoptèrent de nouvelle apparence mondaine et ils
rivalisèrent dans les futilités et les décors pompeux de cette vie
et c’est pour cela que vers la fin du règne d’an-Nassir, les gens
délaissèrent le combat dans la voie d’Allah (jihad fis-sabilillah).
Les
gens raffinèrent leur plats et apparut la grande cuisine et la
recherche de nouvelle recettes.
Zaryab le musicien que nous avons déjà mentionné fut le principal
précurseur de tous ces changements. Il introduisit la mode
vestimentaire avec des habits pour le matin, l’après-midi et le soir
mais aussi pour le printemps, l’été, l’automne et l’hiver et les
historiens ont rapporté que les Arabes ignoraient tout cela
auparavant et ce qui leur importait le plus était de couvrir le
corps sans plus.
Puis
il introduisit aussi les manières de se tenir à table comment
s’asseoir, manger et se lever et aussi les dispositions des
couverts. Il introduisit l’entrée, le repas principal, la salade et
le dessert.
Le service postal et la police
Le
service postal fit son apparition et fut largement amélioré avec la
création de centres postaux disséminés dans toutes l’Andalousie pour
l’entrepôt, le triage et la distribution du courrier.
‘AbderRahmane an-Nassir créa un nouveau corps de police
appelée la police centrale (ash-shorta wasta) spécialisée
dans les affaires commerciales, la surveillance des différentes
corporations comme les docteurs, les dentistes etc., dont les
problèmes diffèrent des affaires courantes. Avez-vous entendu parler
de quelque chose de semblable ?
Il
créa aussi un corps de police pour le jour et un autre pour la nuit.
Il régularisa aussi la police des mœurs (amr bil ma’rouf wa nahi
‘alal mounkar)
Le
trésor public (bayt al-mal) fut divisé en plusieurs
départements : un propre aux Musulmans et un autre propre au
califat.
Il
créa aussi différentes nouvelles administrations : le département de
ressources, des taxes, des douanes, des différents impôts (kharaj,
jizyah) mais aussi des fabriques de monnaies. Préoccupé par les
échanges commerciaux et la circulation de la monnaie, les historiens
rapportent qu’an-Nassir laissa à sa mort plus de 300 millions de
dinars en or. Une somme extraordinaire de nos jours alors que dire
de l’époque ? Seule la dynastie des Hamadaniyah en Syrie
pouvait rivaliser en richesse.
A
l’époque un seul juge était chargé des affaires de justice, mais
‘AbderRahmane an-Nassir créa les maisons de justice, il nomma
des corps entier de juges et il régularisa et améliora la fonction
au niveau juridique islamique : la prise en charge des affaires et
la manière de procéder. Il ordonna que la profession soit ouverte à
tous alors qu’auparavant les juges étaient tous des Arabes.
Yahya
Ibn Yahya al-Leythi, d’origine berbère, devint ainsi un des
plus grand juge de l’époque. Il créa aussi une nouvelle cour de
justice appelée : la cour des opprimés qui correspondrait
aujourd’hui à la cour d’appel.
Il
créa aussi un corps central dans toutes les villes et un responsable
chargé des marchés publiques et des comptes.
Puis
aussi un code de lois et d’éthiques que devaient apprendre tous les
juges améliorant ainsi les droits de tous les individus de même
qu’une université de droit.
L’agriculture et l’aménagement du territoire
Les
plantes et les arbres furent recensés et l’Andalousie devint un
jardin rutilant de toutes espèces d’arbres y comprit fruitiers, de
plantes et de fleurs et parmi les nouvelles espèces, il introduisit,
le riz, les olives, la canne à sucre et le coton.
Il
créa aussi les silos à grains, les entrepôts et une table annuelle
des cultures afin de pouvoir disposer, tout au long de l’année,
toute sorte de fruits, de grains, de légumes et de plantes mais
aussi pour savoir chaque mois ce qui devait être cultivé et récolté.
Il
créa aussi une université agricole dont la science s’étendit partout
en Europe (n’en déplaise aux mauvaises langues) et qui enseigna à
son tour l’agriculture en ces temps de stagnation intellectuelle.
De
même, il révolutionna et améliora la construction, l’architecture et
l’exploitation minière de l’or, de l’argent, du plomb, du fer et du
marbre.
Il
créa des manufactures de cuir, de constructions navales, de
recherches et de fabrication militaires. Des usines de fabrication
d’huiles diverses et de médicaments.
Sous
‘AbderRahmane an-Nassir, apparut aussi les marchés
spécialisés comme ceux des parfums, des plantes, des vêtements, des
viandes, du poisson etc.
Cordoue devint la capitale mondiale de la culture et de l’éducation
pour les Arabes et les non Arabes.
Sous
le règne d’an-Nassir, le nombre de livres de la bibliothèque de
Cordoue atteignit 400.000.
Il
implanta un système de classification et de rangements des livres
par matières et y assigna des gens compétents pouvant informer et
diriger les recherches de n’importe quel visiteur. Cette
bibliothèque fut par la suite totalement brûlée et détruite
jusqu’aux fondations par les croisés du nord pour effacer les traces
de tout ce qui était arabo-musulman de leur pays et détruisirent
ainsi un immense patrimoine scientifique par haine envers l’Islam et
les Musulmans.
Il y
avait aussi des gens spécialisés dans les recherches dont le travail
était de fournir tous les documents concernant tel ou tel sujet à
tout chercheur tandis que lui pouvait faire autre chose en
attendant. Il y avait des écrivains disponibles pour copier sur
demande n’importe quel chapitre, page ou livre mais aussi pour
copier les livres dans leur intégralité.
Les
journaux firent leurs apparitions ainsi qu’un nombre très élevés de
savants parmi eux :
- Le
juge (qadi) ‘AbdAllah Muhammad Ibn Muhammad qui
étudia la science chez deux-cents trente savants (shouyoukh).
-
‘Abdel Qassim Ibn Dabbagh qui étudia chez deux-cents-soixante-trois
savants et qui ne se contenta pas uniquement de cela mais qui partit
à l’est pour étudier chez d’autres savants. Il était un des savants
d’Andalousie les plus renommé à l’est.
- Ibn
‘Attiyah spécialiste de l’interprétation (tafsir) du
Qur’an avec Ibn Waddah, Ibn ‘Abdibbar et Yahya Leythi.
- L’Imam
Bajji, spécialiste de jurisprudence islamique (fiqh) avec Ibn
‘Assim, Moundir Ibn Sa’id. L’Imam Bajji et Moundir Ibn Sa’id
étaient aussi spécialistes du Hadith ou des parole
prophétiques.
- Ibn
Roushd dans la philosophie avec Ibn Massarrah al-Qourtoubi.
- En
linguistique, Ibn Cidah auteur du « mou’jab » (l’étonnant),
Ibn ‘Ali al-Qali auteur du livre « al-amali » (l’espoir).
- Un
des plus grands poètes arabes de tous les temps : Muhammad
Ibn Hani qui mourut très jeune.
- Les
interprétations de livres d’histoire firent leurs apparitions et Ibn
Qoutiyyah excella dans ce domaine.
‘AbderRahmane an-Nassir avait un profond respect pour les
savants et très préoccupé à leurs sujets.
Ceci
n’est juste qu’un infime aperçu du bilan scientifique et culturel
des Musulmans en Andalousie et nous espérons un jour prochain, si
Dieu le veut, vous proposer la traduction d’une excellente œuvre du
Dr al-Jaza'iri sur le sujet.
La fin de ‘AbderRahmane
an-Nassir
‘AbderRahmane an-Nassir li-Dinillah, puisse Allah Exalté lui
faire miséricorde, décéda en l’an 350 de l’Hégire (961). Avant de
parler du règne de son successeur, son fils al-Hakam
al-Moustansir Billah Ibn ‘AbderRahmane an-Nassir disons un
dernier mot en sa faveur comme l’a rapporté Amar Dhina dans son
livre « Califes et Souverains » :
« Physiquement, ‘AbderRahmane, était de taille moyenne, les
cheveux roux, les yeux bleus, d’une santé florissante et d’une
capacité de travail étonnante. Il fut un souverain autocrate, un
organisateur et un réalisateur. ‘AbderRahmane an-Nassir
s’entoura d’une cour comparable, par son faste et son protocole, à
celle des Abbassides.
Le
récit d’al-Maqari de la réception d’une ambassade chrétienne par le
calife en son palais d’az-Zahrah nous donne une idée du raffinement
de l’étiquette de cette manifestation :
« Une
ambassade de Chrétiens du nord étant venue pour être reçue par le
calife, celui-ci voulut les remplir de crainte en leur montrant la
magnificence de sa royauté. Il fit tendre des nattes depuis la porte
de Cordoue jusqu’à la porte de Madinat az-Zahrah, sur une distance
d’un parasange (5 km), et placée à droite et à gauche de la route
une double haie de soldats, dont les armes se rejoignaient à leurs
pointes comme l’arche d’un toit. Sur l’ordre du souverain, les
députés Chrétiens s’avancèrent à travers cette haie. La crainte
qu’ils éprouvèrent à la vue de cet appareil fut inimaginable jusqu’à
ce qu’ils arrivent à la porte de Madinat az-Zahrah. De cette porte
jusqu’au lieu où devait se donner l’audience, le calife avait fait
recouvrir le sol d’étoffes de brocart, et placé, à des endroits
déterminés, des dignitaires qu’on eût pris pour des rois, assis sur
des sièges magnifiques, et revêtus d’habits somptueux. Les députés
étrangers chaque fois qu’ils voyaient l’un de ces dignitaires, se
prosternaient devant lui, s’imaginant que c’était le calife mais on
leur disait : « Relevez la tête ! Ce n’est qu’un de ses serviteurs !
» Ils arrivèrent enfin dans la cour, dont le sol était recouvert de
sable et où se tenait au milieu le calife portant des vêtements
grossiers et courts dont l’ensemble valait à peine quatre dirhams.
Il était assis par terre, la tête baissée. « Voici le monarque »,
dit-on aux ambassadeurs ». La délégation dû être fortement
impressionnée par la comparaison qu’ils firent entre le cérémonial
fastueux d’accueil et la simplicité extrême du calife.
‘AbderRahmane an-Nasir fut aussi un chef de guerre victorieux et un
administrateur remarquable dans beaucoup de domaines.
L’administration de l’état, en grande partie centralisée, paraissait
être inspirée de celle des Abbassides, un siècle après ar-Rashid et
al-Ma'moun, et que Cordoue, en ce quatrième siècle de l’Hégire,
était un peu l’héritière de la civilisation de Bagdad, qui était
déjà sur le déclin.
A
côté de la haute fonction de Hajib, équivalant à celle du
premier ministre, an-Nassir créa la dignité de vizir, dont furent
chargés, tour à tour, des membres de familles influentes arabes,
telles que les Bani Shouhayd, les Bani ‘Abda, les Bani Houdayr.
De nombreux dignitaires ayant des fonctions déterminées étaient
attachés au palais califal comme : le chef de cuisine (sahib
al-matbakh), le chef des écuries (sahib al-khayl),
le directeur des bâtiments (sahib al-bounian), le chef
des postes (sahib al-bouroud), le chef fauconnier (sahib
al-bayazirah), le maitre d’arme (sahib as-sayf),
et bien d’autres.
‘AbderRahmane an-Nassir fut sans doute le premier à
introduire dans sa cour des affranchis d’origine européenne,
as-Saqalibah, à qui furent confiés des offices de chefs de la
maison royale, et qui étaient chargés apparemment de veiller sur la
bonne marche du service, ainsi que de diriger la garde personnelle
du souverain.
L’armée et la marine, réorganisées, étaient commandées par des chefs
qui avaient rang de ministres. Parmi ces chefs, le nom le plus connu
et le plus glorieux est celui du général Ghalib Ibn ‘AbderRahmane.
Le
géographe Ibn Hawqal a rapporté que les revenus de l’état,
sous an-Nasir, atteignaient la somme énorme de vingt millions de
dinars or. Les rentrées d’impôts et autres revenus (awqaf,
butins de guerre, produits de biens domaniaux, etc.) dépendaient du
Sahib Khizanat al-Mal, qui avait la responsabilité des
dépenses. Le domaine propre à la couronne était géré par le
Qahraman. Les revenus du trésor public étaient, en principe,
répartis en trois parts : un tiers pour l’entretien de l’armée, un
tiers pour frais des constructions et l’entretien des édifices
publics ; le reste était mis en réserve. En corrélation avec le
Trésor public, se trouvait l’institut d’émission monétaire, le
Dar as-Sikka, crée dès l’an 313 de l’Hégire (928) par an-Nassir
en dehors de son palais, alors que le Trésor public était conservé
dans une dépendance du palais royal. Les pièces d’or (dinar)
et d’argent (dirham) étaient frappées au nom du calife, et
les pièces frappées chaque année représentaient la somme globale de
200.000 dinars.
Au
début de son règne, ‘AbderRahmane an-Nassir li-Dinillah ou
‘AbderRahmane III résidait, ainsi que ses prédécesseurs, au
palais de Cordoue, contigu à la grande-mosquée. Tous les émirs
omeyyades y étaient inhumés. Les Espagnols l’ont pendant longtemps
appelé l’Alcazar (al-qasr). ‘AbderRahmane, le plus grand
bâtisseur d’édifices publics à Cordoue, travailla à embellir cette
résidence de ses ancêtres, et fit construire un palais à son usage à
qui fut donné le nom de Dar ar-Rawda, et alimentée par l’eau
courante. Selon Ibn Khaldoun, le calife fit venir, pour édifier
cette résidence, des architectes et des maîtres d’œuvres de Bagdad
et de Constantinople. Il fit bâtir également une villa hors de
Cordoue nommée Mounyat an-Na'oura, près de Guadalquivir, au milieu
de jardins irrigués par des machines à eau.
‘AbderRahmane ne semble pas avoir ajouté d’agrandissement à la
grande mosquée ; mais il ordonna la construction de son minaret, à
la place de l’ancien en l’an 339 de l’Hégire (951). Le nouveau
minaret, fort beau, comportait deux escaliers, l’un pour monter,
l’autre pour descendre ; il devait s’écrouler en partie, en l’an
1001 de l’Hégire (1593), suite à un tremblement de terre. Le calife
décida la construction d’un grand nombre de travaux d’utilité
publique, des châteaux forts aux frontières nord, la restauration du
pont de Cordoue, l’édification d’un aqueduc pour amener l’eau dans
sa capitale.
Mais
la construction la plus importante de son règne, comme nous l’avons
déjà mentionné, fut la ville princière de Madinat az-Zahrah, édifiée
à cinq kilomètres du nord-ouest de Cordoue. An-Nassir, comme
beaucoup d’autres souverains, voulut se construire, à petite
distance de sa capitale, une cité à la fois princière et
administrative, et qui n’eût pas les inconvénients de la grande
ville. Mais aucun souverain n’a construit une cité de l’importance
et de la beauté d’az-Zahrah.
Des
dizaines de milliers d’hommes, architectes, maçons, manœuvres,
menuisiers, peintres, décorateurs, couvreurs, etc. travaillèrent à
sa construction durant de nombreuses années. Des sommes
considérables y furent dépensées. Le marbre nécessaire fut importé
principalement d’Ifriqiyah, et il fallut, au dire de l’historien Ibn
Idari, se procurer pas moins de 4.313 colonnes de différentes
couleurs. La ville, située au flanc de la colline, fut bâtie sur
trois plates-formes étagées : la partie supérieure contenait la
résidence du calife et ses dépendances, celle du milieu, les jardins
et celle du bas, comportait les habitations particulières et la
grande mosquée. Les services publics y furent transférés.
Un
jour, le juge (qadi) al-Moundir debout au côté d’an Nassir
regardait al-Zahrah, la superbe ville que le calife fit construire
tandis que les poètes rivalisaient de louanges à propos de la ville,
an-Nassir frémit de joie. Alors sous forme de poème al-Moundir le
rappela à l’au-delà et que Seul le Très Haut était digne de Louanges
et qu’al-Zahrah, un jour ne serait plus.
Et
effectivement, deux siècles plus tard al-Zahrah fut totalement rasée
par les croisés et seule aujourd’hui, la grande mosquée de Cordoue,
reste encore debout défiant les temps, comme un souvenir, un
témoignage et un rappel éternel, tant que tiendra la terre, du règne
glorieux et de l’étincelante civilisation de ‘AbderRahmane
an-Nassir et des Musulmans en Andalousie
Sous
le long règne de ‘AbderRahmane, la civilisation de
l’Andalousie parvint à une apogée qui attira l’admiration de toute
l’Europe médiévale. L’agriculture rivalisait avec l’horticulture, le
commerce avec l’industrie. A côté de la culture des céréales,
l’industrie confectionnait des objets en métal et en cuir. Les
industries andalouses étaient pour une bonne partie des industries
de tissage de vêtement et d’étoffes d’ameublement. Dans les pays
d’élevage, le travail de la laine occupait beaucoup d’artisans et
al-Idrisi vante les étoffes blanches de Bairante et les tapis de
laine de Chinchilla et de Cuenca. Saragosse était réputée pour ses
toiles de lin. Mais c’étaient surtout les tissus de soie dans la
fabrication desquels l’Andalousie musulmane était passée maîtresse
et ce fut l’une des principales sources de richesse de plusieurs
grandes villes, et de Cordoue d’abord qui ne fut supplantée dans
cette industrie par Almeria qu’au moment de la décadence. Il fut
aussi rapporté les tapisseries et vêtements d’apparat de Baza, de
l’industrie de la fourrure, de la pelleterie, du travail des peaux
de castor, de martre-zibeline de Saragosse ; des industries de la
céramique et de la verrerie de Calatayud et de Malaga ; des
mosaïques murales et des carreaux de faïence vernissée (zallij)
; de la fabrication du cristal ; du travail de l’or, de l’argent et
des pierres précieuses, de l’orfèvrerie, de la ciselure des bijoux,
du travail de l’ivoire ; du jais (sabaj) et du cuir repoussé
de Cordoue ; des armes célèbres de Tolède ; des parchemins et
papiers de Xativa, dont le nom Shatibah s’est conservé jusqu’à nos
jours, au moins dans le Sud algérien, dans l’expression « kaghat
shatbi », pour désigner le papier glacé.
Bien
qu’il existait déjà, une armée musulmane, le calife y apporta des
modifications et des perfectionnements dont Ibn Khaldoun nous donne
des détails intéressants. Les forces du calife comportaient trois
corps principaux : une armée permanente, dont le quartier général
était à Cordoue ; un corps de soldats temporaires qui effectuaient
leur service militaire un corps spécial formés de soldats enrôlés ou
volontaires à l’occasion des grandes expéditions. Il faut signaler
également que les armées précédentes portaient le nom de Jound,
alors qu’un autre corps de soldats mercenaires appelé Hasham
se composait surtout d’esclaves qu'on désignait aussi, parfois, sous
le nom de Saqalibah et qui étaient affectés à la garde
personnelle du calife. Leur nombre ne paraît pas avoir été très
élevé. Lors des appels de mobilisation (istinfar), chaque
province devait fournir un nombre de soldats fixé à l’avance.
L’auteur du Bayan rapporte que les habitants de Cordoue
étaient dispensés du service militaire pour la raison que cette
ville fournissait suffisamment de volontaires. Les expéditions
militaires avaient lieu la plupart du temps en été et plus rarement
en hiver.
‘AbderRahmane an-Nassir veillait personnellement à la préparation
des expéditions militaires. La concentration des troupes se faisait
à Cordoue où l’on procédait à leur équipement. Le calife an-Nassir
donnait une certaine solennité au départ des expéditions. Le prince
passait ses troupes en revue, et s’occupait personnellement des
détails d’organisation des colonnes ».
‘AbderRahmane an-Nassir régna cinquante années, sept mois et
trois jours. Il a été rapporté qu’il a été trouvé à sa mort, une
note de sa main sur le nombre de jours de félicité sans soucis qu’il
goûta dans cette vie : le jour untel du mois untel de l’année untel,
le jour untel du mois untel de l’année untel etc. Ces jours ont été
dénombré à quatorze sur à peu près 18.350 jours !
Pensez donc à ce qu’est la vie sur terre et que cette vie n’a aucune
valeur. Qui parviendra à la gloire d’an-Nassir ? Cinquante années de
règne pour tout compte fait ne connaître que des peines.
Prenons donc et apprenons des leçons de notre histoire. Ne nous
accrochons pas à la vie de ce monde car elle n’est en fait que le
champ de culture pour la vie future. Patientons et supportons tout
ce qui nous arrivera en espérant la récompense du jardin de
l’éternité.


An-Nassir, puisse Allah lui faire miséricorde, décéda en l’an 350 de
l’Hégire (961) et lui succéda son fils Al-Hakam al-Moustansir
Billah Ibn ‘AbderRahmane an-Nassir, qui était alors âgé de
vingt-sept ans. Il était lui aussi, puisse Allah lui faire
miséricorde, un homme du futur, amoureux des livres, de la culture
et de la science.
Il
était surnommé « l’amoureux des livres », un savant des différentes
écoles de jurisprudence, un Imam de la généalogie, protecteur
de l’Histoire, amis des savants, des philosophes et des historiens,
bibliophile et un étudiant assoiffé de sciences. A tel point que
s’il entendait parler d’un livre réputé, il faisait tout pour entrer
en sa possession. Il eut vent d’un livre écrit par al-Asfahani
d’Ispahan en Iran titré « al-aghan » dont il acheta l’édition
originale pour la somme de 1.000 dinars d’or.
Al-Hakam
al-Moustansir Billah émit aussi l’ordre à tous les savants
d’enseigner l’apprentissage du Qur’an aux enfants des pauvres
et des faibles et il créa à cet effet un corps administratif spécial
chargé de gérer les centre d’accueil et les dépenses relatives à ce
projet.
L’agrandissement de la grande mosquée de Cordoue
La
première entreprise qu’il mena à bien, puisse Allah lui faire
miséricorde, est qu’il agrandit la grande mosquée de Cordoue (qortoba)
que l’histoire lui attribut effectivement.
Il se
passa un fait étrange lors de l’agrandissement de cette mosquée.
Lorsque les travaux aboutirent, il invita les gens à venir prier
dans la mosquée mais ils refusèrent. Il s’enquit des raisons de ce
refus et il apprit que les gens disaient qu’il avait agrandi la
mosquée avec de l’argent illicite (haram).
Il
fit réunir tous les gens et tous les savants et porta serment devant
eux de n’avoir utilisé que de l’argent licite (halal)
parvenant du cinquième du butin (al-ghana'im). Alors tous les
gens revinrent prier à nouveau dans la grande mosquée.
Ce
petit événement que nous ont rapporté les historiens nous montre
combien les gens de cette époque étaient scrupuleux en ce qui
concerne les affaires de la religion. Aujourd’hui, personne
n’oserait s’adresser de telle sorte à un dirigeant des pays
Musulmans sans craindre pour sa vie, et celle de toute sa famille
réunie.
Les campagnes ordonnées par al-Hakam
al-Moustansir Billah
En
l’an 352 de l’Hégire (963), les croisés de Jalalitah au nord,
voulurent prendre la température des Musulmans et leur armée déferla
sur une ville musulmane du nord. Alors al-Hakam envoya son
armée qui réussit à prendre la forteresse de San Estéban (san
istifan). Lorsque les croisés (salib) virent la force des
Musulmans, ils demandèrent la paix qui leur fut accordée.
Un
autre armée de croisés attaqua aussi une autre ville et al-Hakam
leur envoya son armée commandée par Ghalib Ibn ‘AbderRahmane
qui les écrasa.
En
l’an 352 de l’Hégire (962), la tribu des Basques (bashkans)
et leur gouverneur Sancho annonça sa rébellion et la fin du pacte
qui le liait avec les Musulmans. Al-Hakam al-Moustansir
Billah lui envoya at-Tajibi, le gouverneur de Saragosse, la capitale
la plus proche du nord. At-Tajibi pulvérisa et dispersa leur armée
prouvant ainsi son allégeance à al-Hakam et qu’une ville des
musulman était capable de vaincre les ennemis seule. C’est le legs
que laissa ‘AbderRahmane an-Nassir à son fils.
Cette
même année, at-Tajibi marcha sur Barcelone (barshalona) et
détruisit la ville tandis que Ghalib Ibn ‘AbderRahmane prit
la forteresse de Qalharah et y fit habiter des Musulmans alors
qu’auparavant elle était aux mains de Sancho.
Cette
même année, les Basques se rebellèrent à nouveau et Sancho résilia
le pacte qu’il avait signé avec les Musulmans. Ordogne IV (ordonio
rabi’) lui disputa le pouvoir et demanda de l’aide à al-Hakam
qui répondit favorablement à sa demande. Sancho pressentant le
danger demanda de l’aide à Léon mais Ferdinand le roi refusa. Entre
temps, Ordogne IV décéda et Sancho en profita pour demander encore
une fois la paix avec les Musulmans faisant savoir combien il était
(hypocritement) désolé et contrit d’avoir trahit don pacte. Al-Hakam
al-Moustansir Billah Ibn ‘AbderRahmane an-Nassir accepta ses
excuses et renouvela l’acte de paix avec lui.
La
paix prévalut un certain temps avant que de nouveaux troubles
surgissent à l’ouest et au sud.
Le retour des Normands et la menace ‘oubaydi
A
l’ouest, vingt-huit navires Normands attaquèrent la forteresse
d’Abidanis ou une bataille eut lieu. La flotte musulmane de Séville
sitôt informée fut dépêchée sur place et mit en déroute les Normands
après avoir brûlé un grand nombre de leurs navires. Il n’était plus
possible maintenant aux Normands d’effectuer des raids en toute
impunité du fait que le pays était unifié et préparé aux menaces
externes.
Quant
au sud, les ‘oubaydi réussirent en l’an 358 de l’Hégire (968) à
conquérir l’Egypte et en firent leur capitale. De là, ils
capturèrent la Péninsule Arabique (al-hijaz) puis la
grande Syrie (sham) ou ils commirent les pires infamies
envers les Musulmans avant de se tourner vers l’Andalousie.
Le
vil (khabith) calife ‘oubaydi al-‘Aziz Billah, le fils d’un
mage juif, envoya une lettre menaçante au calife omeyyade (amawi)
al-Hakam al-Qourayshi qui lui répondit une courte mais
incisive réponse : « Comme tu nous connais tu nous insultes mais si
nous t’avions connu, nous t’aurions répondu ».
Comme
nous l’avons déjà mentionné, l’enclave de Ceuta faisant face au
détroit de Gibraltar avait été conquise par an-Nassir et était
toujours aux mains des Omeyyades et sentant le danger arriver, al-Hakam
al-Moustansir Billah traversa pour Ceuta d’où il attaqua Tanger, la
ville la plus proche, qu’il réussit à capturer si bien que les deux
villes principales du nord du Maghreb, faisant face à l’Andalousie,
étaient désormais aux mains des Omeyyades.
La
situation resta ainsi jusqu’en l’an 360 de l’Hégire (970) quand les
Normands tentèrent une cinquième incursion et en l’an 361 (971) une
sixième attaque. Mais la flotte des Musulmans vint de Séville puis
d’Almeria, la capitale maritime, et réussit à chasser une nouvelle
fois les Normands.
En
l’an 361 de l’Hégire (971), les Berbères qui étaient les habitants
originaux du Maghreb, se rebellèrent contre les ‘oubaydi ismaéliens
et demandèrent de l’aide aux Omeyyades qui acceptèrent aussitôt
leurs demandes en leur envoyèrent troupes et logistiques.
Cette
alliance réussit à vaincre puis tuer leurs gouverneurs et à expulser
les ismaéliens.
Puis
un groupe de Berbères appelés les Adarissah se rebellèrent à leur
tour et capturèrent le petit Maghreb (Maroc) et Tanger d’où ils
expulsèrent les Omeyyades.
Al-Moustansir eut peur de cette nouvelle menace sachant que les
Adarissah ne tarderaient pas à chercher de nouveaux espaces à
conquérir. Il ordonna au commandant de sa flotte ‘AbderRahmane
Ibn Ramahiss, stationné à Ceuta, d’attaquer Tanger gouvernée
par Hassan Ibn Maknoun. ‘AbderRahmane attaqua la ville
et réussit à la reprendre et à expulser les Adariss.
Hassan
Ibn Maknoun s’enfuit vers la forteresse de Nissar. Al-Moustansir lui
envoya un de ses commandants Ghalib Ibn ‘AbderRahmane et la
bataille entre les Omeyyades et les Adarissah commença. Les forces
Omeyyades du Maghreb commandées par Yahya at-Tajibi se
joignirent à lui et se trouvait dans cette armée, un simple soldat
inconnu du nom de Muhammad Ibn Abi ‘Amiri. Rappelez-vous son
nom car par la suite, cet homme va changer le cours de l’Histoire et
atteindre une grande renommée dans l’histoire de l’Andalousie.
Les
forces alliées des Omeyyades réussirent à venir à bout de tous les
rebelles et prirent la forteresse après un long et difficile siège.
Ghalib réussit à acheter certains Adariss avec de l’argent et il fit
prisonnier Hassan Ibn Maknoun qu’il emmena en Andalousie.
En
l’an 365 de l’Hégire (975), le ministre d’Etat Muhammad
al-Moushafi expulsa Hassan Ibn Maknoun au Maghreb. Puis du
Maghreb, il fut expulsé vers la Tunisie qui le trouvant indésirable
l’expulsa en Egypte. En Egypte, les ismaéliens l’accueillirent à
bras ouvert et l’honorèrent. Son histoire continuera comme nous le
verrons plus tard.
Grâce
à sa bravoure, lors de la prise de la forteresse, Muhammad
Ibn Abi ‘Amiri monta de grade en grade. Du soldat qu’il était, il
devint policier puis commandant des forces de police de Cordoue, le
quatrième homme le plus important de l’état : le calife étant le
premier, le Ministre (wazir) second, Ghalib Ibn ‘AbderRahmane
commandant des forces armées troisième et Muhammad Ibn Abi
‘Amiri grâce à sa valeur et à ses ambitions devint le quatrième en
très peu de temps.
Vers
la fin de son règne al-Moustansir Billah Ibn ‘AbderRahmane
an-Nassir fut atteint de cataracte qui l’empêcha de régner de
manière correcte et les affaires d’état passèrent entre les mains
des ministres et des femmes du palais, signe de décadence de l’état.
Bien évidemment les croisés au nord profitèrent de la situation qui
s’aggrava au nord.
Hisham al-Mouayyad
Billah Ibn al-Hakam
al-Moustansir Ibn ‘AbderRahmane
an-Nassir
En
l’an 366 de l’Hégire (976), décéda al-Hakam al-Moustansir Ibn
‘AbderRahmane an-Nassir, puisse Allah lui faire miséricorde
ainsi qu’à son père. Il laissa pour successeur après lui, son fils
Hisham, un enfant alors âgé de 10 ans.
Hisham fut appelé al-Mouayyad Billah mais c’était un enfant
incapable de gouverner et sa mère du nom de Soubh d’origine
basque, gouverna à sa place et pour protéger son fils jusqu’à ce
qu’il grandisse, un conseil non Omeyyade fut chargé de diriger
temporairement l’état qui consistait en trois hommes :
- Le
ministre d’état al-Hajib Ja’far Ibn ‘Uthman al-Moushafi,
- Le
commandant en chef des armées Ghalib Ibn ‘AbderRahmane et,
- Muhammad
Ibn Abi ‘Amiri devenu chef des forces de police tant pour sa
bravoure que son travail acharné pour les forces de police et sa
grande ambition.
Et
avec l’histoire de Muhammad Ibn Abi ‘Amiri nous arrivons dans
une nouvelle ère dans l’histoire de l'Andalousie : l’ère d’al-Hajib
al-Mansour.
Nous
allons voir comment ce jeune homme Muhammad Ibn Abi ‘Amiri,
simple soldat inconnu, parvint à la gloire nous faisant ainsi
rappeler l’histoire de ‘AbderRahmane ad-Dakhil qui seul
réussit à devenir émir d’Andalousie alors que sa tête était mise à
prix dans tout l’empire musulman.
De
même Muhammad Ibn Abi ‘Amiri, seul, un homme sans aucune
importance, sans aucun pouvoir particulier, sans tribu, sans argent
et sans relation pour le porter, réussit à diriger l’Andalousie.
|
|

