
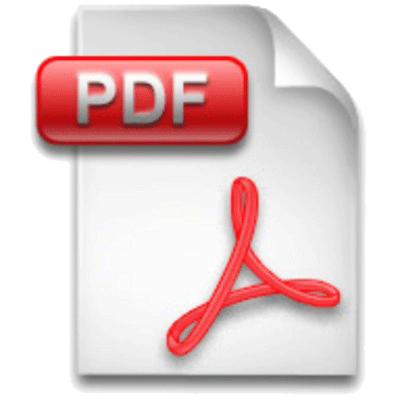 |
Règne : 1012-1026 (1603-1617)
Titres honorifiques et pseudonymes
: Ghazi (guerrier de la foi), Bahti.
Nom du Père
: Muhammad III.
Nom de la Mère :
Sultan Handan
Lieu et date de naissance
: Manisa, le 22 Joumadah ath-Thani 998 (28 avril 1590).
Âge à l’accession au trône
: 14 ans.
Cause et date du décès : Typhus et saignements gastriques ;
23 Dzoul Qi’dah 1026 (22 novembre 1617).
Lieu de décès et de sépulture
: Istanbul. Sa tombe est située près de la Mosquée du Sultan
Ahmed, dans Istanbul.
Héritiers
: ‘Uthman II, Mourad IV, Ibrahim, Bayazid, Souleyman,
Qassim, Muhammad, Hassan, Salim, Hanzade et
‘Oubaydah.
Héritières
: Sultan Gevherhan, Sultan ‘Ayshah, Sultan Fatima et Sultan
‘Atika.
À la suite de la mort de son père Muhammad III, Ahmad
Ier monta sur le trône à un âge précoce en tant que premier
sultan sans expérience préalable de gouverneur, ce qui
aurait été trop risqué face à la montée des révoltes Celali
dans les provinces anatoliennes.
Au moment où Ahmed Ier reçut le trône, l’Empire Ottoman
était en état de guerre contre l’Autriche à l’ouest et les
shiites à l’est. L’armée ottomane sous le commandement de
Cigalazade Sinan Bacha passa cet hiver à Van, au sud-est de
l’Anatolie, sans faire de campagne. Sinan Bacha déplaça
l’armée à Erzurum dès que les shiites avaient attaqué ;
toutefois, son entreprise suscita la gêne parmi les soldats
conduisit l’armée à ménager une saison de campagne en vain.
Finalement, l’armée marcha dans le but de conquérir Tabriz
en 1013 (1605). L’armée ottomane défit les shiites mais le
commandant général Sinan Bacha se retrouva dans une
situation difficile lorsque le gouverneur général d’Erzurum
Sefer Kose Bacha détacha ses troupes de l’armée ottomane
pour chasser l’ennemi et fut capturé et détenu prisonnier de
guerre. Shah Abbas organisa une embuscade à un moment
critique et vainquit les troupes de Sefer Kose Bacha. Les
forces ottomanes restantes se retirèrent d’abord à Van, puis
à Diyarbakir, situé sur les rives du Tigre. Après la mort
soudaine de Sinan Bacha à Diyarbakir, Shah Abbas captura
facilement Sirvan, Samakhi et Ganja dans le sud du Caucase.
L’Empire Ottoman n’affecta pas toutes ses forces à la lutte
contre les shiites, car il combattait simultanément
l’Autriche et le conflit interne en Anatolie s’aggravait.
Par conséquent, la guerre contre les shiites se termina par
la signature d’une trêve nommée en l’honneur du Grand Vizir
Nasouh Bacha.
Le défi de taille sous le règne du Sultan Ahmed I
vint avec les révoltes qui éclatèrent en Anatolie. La montée
des révoltes occupa une grande partie de son attention et
s’étendit à une sphère d’influence plus large. Les révoltes
à peine contrariées en entraîneraient d’autres dans les
années à venir. En outre, le mécontentement suscité par les
guerres intermittentes ottomane-autrichiennes augmenta
lorsque de plus en plus de taxes alourdirent les sujets
ottomans. De plus, les unités de cavalerie timariot
titulaires de fief, qui devaient se réunir avec l’armée en
temps de guerre et s’occuper de la terre qui leur avait été
confiée en temps de paix, montraient des signes de faiblesse
et formaient des cavaliers de moindre importance pendant les
campagnes. Les soins et le contrôle des terres provinciales
confiées aux timariots diminuèrent également. Cela donna un
élan à la migration des zones rurales vers les villes,
provoqua l’abandon des villages et des fermes et réduit les
recettes fiscales du gouvernement pour la production
agricole sur les terres timariotes.
Au moment où Ahmed Ier accéda au trône, les Ottomans
avaient mené des batailles féroces contre l’Autriche comme
ils le furent sous le règne de son père. La reconquête des
forts de Visegrad et d’Esztergom en 1013 (1605) contribua à
la consolidation de l’autorité ottomane en Valachie, en
Moldavie et en Transylvanie, et le maintien du statu quo fut
également reconnu par les Princes valaques, moldaves et
transylvaniens, qui étaient agités par l’Autriche contre
l’Empire Ottoman. L’Autriche n’eut alors d’autre choix que
de demander la paix. Le Traité de Zsitvatorok suivant, signé
à l’ancienne embouchure de la Zsitva, se jetant dans le
Danube, en 1014 (1606), stipulait que les Ottomans
conserveraient les forteresses d’Egri, d’Estergom et de
Kanizsa. Bien que le traité semblait favoriser l’Empire
Ottoman, il fut néanmoins révélateur de la future stagnation
ottomane en Europe.
En concluant le Traité avec le Kaiser autrichien, le Sultan
Ottoman reconnut le souverain autrichien pour la première
fois comme son égal diplomatique. Il s’agissait de la
première occasion d’égalité diplomatique entre un sultan
ottoman et les monarques européens voisins, auxquels les
Ottomans avaient précédemment attribué un statut subordonné
égal à celui du Grand Vizir du Sultan. Ainsi, la supériorité
ottomane absolue en matière de diplomatie internationale,
depuis l’époque du Sultan Souleyman le Magnifique, prit fin.
Le renouvellement du Traité dans les années suivantes fut en
grande partie dû aux révoltes incessantes de Celali qui
causèrent de graves problèmes aux Ottomans. Le Sultan Ahmed
Ier renouvela également les privilèges de libre-échange
accordés par les Sultans précédents à la Grande-Bretagne, à
la France et à Venise ; il accorda également les mêmes
privilèges à la Hollande.
Les chroniques indiquent qu’Ahmed I, qui devint le
quatorzième Sultan ottoman à 14 ans et régna pendant
quatorze ans, rencontra très tôt son destin en raison d’une
hémorragie gastrique, le 23 Dzoul Hijjah 1026 (22
décembre 1617). Comme de nombreux autres Sultans, le Sultan
Ahmed écrivit de nombreux poèmes sous son pseudonyme
« Bahti. » Le Sultan Ahmed Ier, homme de religion et
de bienfaisance, fut apprécié et respecté par ses sujets, en
partie parce qu’il s’abstenait de plaisirs et de
divertissements. En matière d’état, il exécuta sans relâche
les peines infligées à ceux qui faisaient preuve d’abandon
ou de traîtrise à leur poste. En fait, la montée des
révoltes et son incapacité à les réprimer pendant son règne
semblent l’avoir contraint à gouverner de stricte manière
afin de rétablir son autorité.
Au cours de son règne, le changement le plus important de
l’appareil d’état eut lieu avec la réforme des règles
d’adhésion au trône ; en particulier, il abolit l’exécution
de fratricide qui avait émergé lorsque les Shehzades avaient
été contraints à la succession pendant la guerre civile
après la défaite du Sultan Bayazid Ier lors de la bataille
d’Ankara en 804 (1402) et avait promulgué de nouvelles lois
sur la succession fondées sur l’ancienneté et la maturité
politique personnelle. Conformément aux nouvelles lois,
Mustafa I, le frère du Sultan Ahmed, devint héritier
de droit au trône. En outre, la pratique consistant à
envoyer les Shehzades dans les provinces en tant que
gouverneurs pour acquérir une expérience militaire et
administrative fut abandonnée ; au lieu de cela, ils vinrent
à être retenus dans les pavillons jumeaux du Palais de
Topkapi.
Le nouveau système de succession fondé sur l’ancienneté et
la maturité conduisit les sultans ottomans à régner à des
âges bien plus avancés. De plus, l’abolition de la tradition
des Shehzades en tant que gouverneurs de provinces (sancak)
réduisit l’opportunité pour les Shehzades d’acquérir une
formation et une expérience administrative. À partir du
Sultan Ahmed Ier, le trône commença à passer rarement
du Sultan à son propre fils mais généralement à son frère,
le membre le plus âgé de la dynastie. Aujourd’hui, le chef
de famille de la dynastie ottomane est toujours déterminé
par la règle de l’ancienneté. Contrairement aux attentes,
les principes d’ancienneté et de maturité n’empêchèrent pas
les luttes pour la succession entre frères. Cependant, un
consensus classique parmi les historiens est que les
héritiers fratricides du Sultan nouvellement intronisé au
trône avaient été appliqués en particulier sous les règnes
de Mourad III et Muhammad III afin d’étouffer toutes
les ambitions de rivaux potentiels au trône. D’autres
incidents malheureux semblent s’être produits alors qu’ils
ne pouvaient pas être évités. Il était inévitable que les
membres de la dynastie qui menaient des compétitions
sanglantes pour le trône perdent la vie en cas d’échec.
Le Sultan Ahmed I construisit la Mosquée Sultan Ahmed,
le grand opus de l’architecture ottomane, en face de la
Mosquée Ayasofya. Le Sultan assista aux premiers travaux de
terrassement avec une pioche en or pour commencer la
construction du complexe de la mosquée. Sultan Ahmed
participa avec joie à la onzième rénovation complète de la
Ka’bah, qui venait d’être endommagée par les inondations. Il
envoya des artisans d’Istanbul et la gouttière d’or qui
empêchait la pluie de s’accumuler sur le toit de la Ka’bah
fut rénovée avec succès. C’est encore à l’époque du Sultan Ahmed
Ier qu’un filet de fer fut placé à l’intérieur du puits de
Zamzam à La Mecque. La mise en place de ce filet à environ
trois pieds sous le niveau de l’eau était une réponse aux
insensés qui sautaient dans le puits, imaginant la promesse
d’une mort héroïque.
À Médine, une nouvelle chaire en marbre blanc et expédiée
d’Istanbul arriva à la Mosquée du Prophète (sallallahou
‘aleyhi wa sallam) et remplaça l’ancienne chaire usée. On
sait également que le Sultan Ahmed Ier érigea deux
autres mosquées à Uskudar, du côté asiatique d’Istanbul
cependant, aucun d’elles ne survécurent. Le Sultan avait un
emblème sculpté de l’empreinte du Prophète Muhammad
(sallallahou ‘aleyhi wa sallam) et illustrait l’un des
exemples les plus significatifs d’affection envers le
Prophète (sallallahou ‘aleyhi wa sallam) dans l’histoire
ottomane.
Il composa un quatrain gravé à l’intérieur de la crête : «
Si seulement je pouvais supporter ma tête comme mon turban
pour toi, toujours…»
|

